I.50 – Récits d’un méditant
La méditation est une expérience qui me permets de voir plus loin que toute doctrine et que toute spéculation, plus loin que l'expérience que j'ai de moi-même, plus loin que l'expérience elle-même. Ce que je perçois, ce que je discerne, va au-delà des sens, au-delà des mots. Lorsque je médite, je me découvre du songe de ma propre apparence.
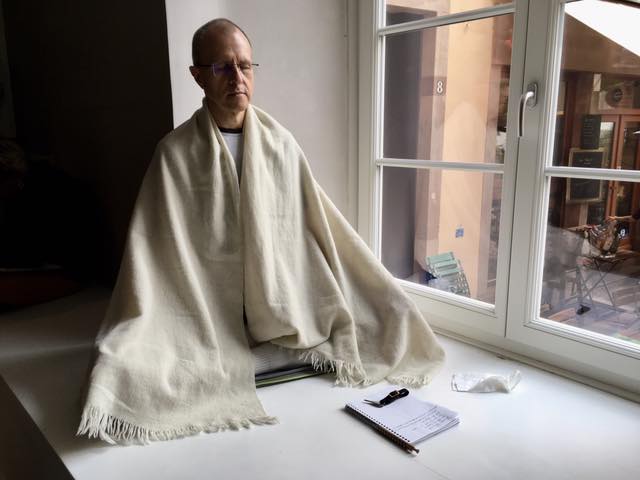
Le Bouddhisme est une connaissance par l'expérience. Les enseignements du Bouddha insistent sur l'importance d'expérimenter et d'investiguer par soi-même - pour « passer par-delà » ma subjectivité et saisir la relativité de mon esprit -. La finalité est la libération (l'Éveil), à la fois « Connaissance et délivrance » de la connaissance elle-même. Pour le Bouddhisme, la libération (le nirvana) est l'apothéose de l'expérientiel,
« une adhésion de foi serait sans valeur (...) fonder [vos] croyances sur la recherche et l'examen personnels et n'adhérer aux théories [et aux doctrines] qu'après avoir reconnu, par [vous]-mêmes, qu'elles correspondent à des faits réels » BB-139.
Lorsqu'il prit de la mescaline, l'auteur des « portes de la perception » AH-PP appliqua une méthodologie scientifique à l'examen minutieux de ses états de conscience. Quel que soit le degré d'enivrement, ce type de consommation est contre-productif à la réalisation du Bouddhisme. « La poursuite de la Connaissance au moyen de l'attention, de l'observation, de l'analyse et de la réflexion, exige la lucidité de l'esprit ; tout ce qui est capable de diminuer la clarté des perceptions, de déterminer une excitation morbide des sens et de l'esprit ou de les plonger dans la torpeur est, par-dessus tout, à éviter » BB-179.
Aldous Huxley n'en a pas moins réalisé un travail d'analyse méthodique qui gagne à être reproduit avec la méditation. Samadhi et nirvana ne sont pas des états « d'extase », mais, comme l'a défini Mircea Eliade[i], « d'enstase ». La méditation est une pratique non hallucinogène (et en vente libre) qui nous permet de passer d'un mode de conscience à un autre sans danger (mais pas sans effet secondaire positif). Méditer ne déclenche pas de visions aussi colorées que celles décrites par Huxley, mais l'examiner avec méthode est essentiel.
« Rien ne doit nous échapper de ce qui se passe en nous » BB-84.
Il s'agit de développer notre attention sur des points d'observation précis et successifs : du corps (respiration, position, mouvement...) ; des sensations ; des pensées ; des phénomènes internes (émotions, sentiments) ; du travail de l'esprit, « la pratique de l'attention parfaite est un moyen d'apprendre à se connaître soi-même et, par conséquent, d'acquérir des Vues justes » BB-85.
La méditation n'est pas une forme de raisonnement, mais le bouddhisme (en particulier tibétain) mêle observation attentive et investigation. « Celui qui pratique l'attention, selon la méthode bouddhique, ne doit pas se laisser aller à ses impulsions sans les examiner » BB-85. Le programme d'entraînement spirituel tibétain consiste ainsi à : « 1. regarder, examiner / rechercher la signification, la raison d'être des choses ; 2. réfléchir, méditer / étudier celles-ci dans leurs détails ; 3. pratiquer / comprendre » BB-117. La méditation sur les « quatre sentiments infinis ou sublimes » débute par un « état de réflexion et de recherche » menant à un état « d'unité et d'élévation d'esprit », puis de « conscience clairvoyante » pour aboutir enfin à la « parfaite sérénité ».
L'importance portée à l'observation attentive de ce qui se passe dans la méditation vise à percevoir la nature composite du corps, de la personne et de l'esprit, qui est la nature fondamentale de toutes choses, l'impermanence. « Chez les Mahâyânistes, la pratique de l'attention vise à imprimer dans l'esprit le spectacle de la mobilité des formations mentales (...) Une pratique assidue conduit à percevoir les objets environnants et à se percevoir soi-même, sous l'aspect d'un tourbillon d'éléments en mouvement » BB-102.
Observer attentivement les fluctuations de cette mouvance sans se laisser entraîner par le mental ni emporter par les divagations de l'imaginaire, est rendu possible par le fait d'établir une distance (mentale et émotionnelle) avec les phénomènes qui se déroulent dans la sphère de notre esprit. Pour cela, il importe « d'habiter » une posture « d'observateur neutre » en fixant un point d'observation comme le souffle et d'y rester concentré. Cette neutralité de l'observateur est l'état naturel de l'esprit. Nous sommes déjà dans ce qui est recherché. Nous n'avons rien à développer !
En somme, l'attention portée à l'observation ne permet pas de voir la réalité « telle qu'elle est » au terme du développement (particulièrement assidu) d'une faculté dont il s'agirait de cultiver et d'amplifier l'acuité, mais (sans être pour autant plus facile) à révéler cette capacité cachée par « l'épuration du mental ». Selon le Bouddhisme zen,
« l'esprit dans son état naturel perçoit la Réalité. Ce qui l'en empêche, c'est le jaillissement continuel des idées qui le troublent et le rendent pareil à l'eau agitée par le vent, dans laquelle les objets produisent des images déformées » BB-124.
Le mythe hindou du « barattage de la mer de lait » est symbolique de cet état de confusion de l'esprit en proie à de continuelles fluctuations (citta vritti), soumis à l'illusion du « moi », tiraillé entre ses démons et ses démiurges intérieurs (influences conditionnées et conditionnant : vasanas, « foule des autres », etc.) à l'œuvre au sein de l'agrégat constitutif de sa personne. « La vigilance (l'observation attentive) est la Voie qui mène à l'immortalité (...) à la « non-mort » (amrita) - l'éternité ne comportant ni naissance, ni mort » BB-84.
Les termes de naissance et de mort se comprennent ici comme signifiants du surgissement et de la disparition des pensées en flots continus. L'état naturel de l'esprit - qui perçoit, voire, coïncide avec la Réalité - se comprend comme une forme de «vacuité mentale » sans début ni fin, « éternelle » donc ! « L'attention vigilante nous conduit (...) à atteindre un point de vue d'où s'entrevoit l'au-delà des paires de contraires : vie et mort, être et non-être, tels que notre vision fragmentaire nous les représente » BB-84.
Observer avec attention n'assure pas de rester concentré, d'empêcher les pensées de surgir, ni de ne pas se laisser distraire. Un instant mon attention est ancrée fermement sur ma respiration, l'instant suivant je me surprends à divaguer dans l'imaginaire... Développer mon attention me permets de voir que ceci, une pensée qui surgit, n'est autre que l'opportunité de cela, le surgissement d'une autre pensée, « le disciple entraîné discerne une succession continuelle de manifestations soudaines n'ayant que la durée d'un éclair, la continuité apparente de sa propre personne étant causée par la rapidité avec laquelle ces éclairs se succèdent » BB-102.
Avec de l'attention, je parviens à observer cette collection des pensées sans y participer ni me laisser entraîner dans leur courant. « Si l'esprit atteint cet état, ne fût-ce que pour un moment, il comprend la naissance et la création des formations mentales » BB-125. Cette compréhension est expérientielle, c'est une connaissance directe.
Je vois chaque pensée individuellement. J'observe son surgissement (sans pour autant savoir comment elle se forme en-dessous du seuil de ma conscience). Je comprends son caractère et je saisis la raison pour laquelle je crois causal le discours du mental par lequel je me laisse séduire car il me confère un sentiment d'unité. Puis, je vois tout cela s'évanouir à l'instant de mon retour au « moment prēsent »... « Ce qui est en dehors de la naissance des formations mentales (samskâras) et ce qui met instantanément un terme à celles-ci, est la Réalité » BB-125.
La méditation me permet de prendre conscience du caractère composite de ma personne, de discerner l'illusion du moi à travers le flux acausal de ces pensées qui ne m'appartiennent pas, dont « je » ne suis que le témoin (lui-même passager) de l'écoulement d'un contenu phénoménologique dont je ne suis pas à l'origine (volontaire).
Observer le surgissement et la disparition des pensées dans l'instantanéité de «l'éternel retour de l'instant » révèle les ressorts (neuropsychiques) qui occultent leur impermanence et masquent les origines multiples (et inconscientes) de sa production. « Il est question de constater l'irréalité du monde imaginaire que créent les idées que nous entretenons ou qui surgissent spontanément en nous sans le concours de notre volonté et même contre celle-ci » BB-125.
Nous confondons souvent effort et intensité en croyant que l'efficacité se mesure à l'énergie déployée à la réalisation de notre but. Se concentrer, s'est fixer son attention sur une chose en y restant présent. Cette forme « d'effort » exclut l'intensité. Le non-faire est essentiel. L'objet de la concentration est présent à l'esprit sans avoir à y penser de manière « mentale ».
L'intérêt de la méditation Anapana sur d'autres « formes de concentration » est la détente induite. Tout le corps est relâché. La concentration se porte sur l'entrée et la sortie de l'air au niveau des narines. La sensation est très diffuse, c'est là toute la difficulté. L'attention se développe toutefois d'autant mieux que l'intensité n'est ici d'aucun secours. La concentration n'est pas une capacité, c'est un état qui coïncide avec la saisie de l'instant présent aux limites de la perception et de la représentation, dans ce qu'elle a de non-mental, c'est-à-dire dans son êtreté même.
La pratique de ce type de méditation nous apprend à nous installer dans un juste milieu, sans trop d'intensité ni de relâchement, et à nous y maintenir, d'y « demeurer » pour reprendre un terme propre au bouddhisme tibétain. Son expérience enseigne la primauté du relâchement sur l'intensité et le sens que nous devons leur donner.
Méditer, c'est « demeurer » fermement (sthira) observateur dans un espace de relâchement mental (sukham). Quel que soit ce qui peut advenir à cet instant, quel que soit ce qui peut surgir dans le courant du devenir du mental, ne pas entrer dans le spectacle, « l'esprit, observateur et tranquille, regarde passer le flot ininterrompu des idées qui se pressent à la suite les unes des autres » BB-124.
Namasté
I.50.1 - Qui suis-je ?
I.50.2 - Unité corps-esprit
1.50.3 - La sensation du présent
1.50.4 - Entre les interstices
1.50.5 - Le mouvement immobile
1.50.6 - Changer de plan
1.50.7 - L'instrument de conscience
1.50.8 - L'intensité du souffle
1.50.9 - Haute sensibilité
1.50.10 - Sérénité profonde
1.50.11 - Fermeté et aisance

I.50.1 - Qui suis-je ?
- Installé dans la posture
de méditation, je me focalise sur l'air qui entre et sort de mes narines.
J'expire longuement, j'inspire naturellement. J'approfondis le voyage de ma
respiration. Je me calle sur son rythme lancinant. Ma conscience s'expand. Je
sens mes sens à l'affût du moindre stimuli.
- Des images apparaissent et disparaissent, mêlant sujets à étonnement et insensibilité, intérêt et désaffection. Aucune ne semble avoir de rapport ni de lien hormis, peut-être, l'analogie de leur enchaînement. Rien ne semble émis à volonté ou par tâtonnement. L'observation m'entraîne toutefois à m'interroger. Le Bouddhisme nous y enjoint. « L'esprit doit être observé dans son état tranquille de repos ; Il faut examiner quelle est la nature de cette "chose" immobile ; Examiner comment cela, que l'on dénomme esprit, reste en repos et comment il se meut en sortant de sa tranquillité » BB-103.
- Je question me viens. Qu'est-ce que le
ciel ? Sans les qualificatifs sous lesquels il nous apparaît (bleu,
nuageux, étoilé, etc.) qu'est-il réellement ? Un lieu, une étendue ?
Mais qu'est-ce qu'un lieu sans contenu et une étendue qui n'est pas l'extension
d'un « quelque chose » ? La perception du problème remplace alors
sa pensée. Je m'aperçois que les pensées
ne sont rien d'autres qu'un contenu qui n'est pas différent d'images fantasmées.
- En observant le flot de mes pensées surgissant aléatoirement dans le silence de la méditation, je me rends compte que mon mental s'emplit de leur contenu comme mes sens s'emplissent des stimulus au contact du monde lorsque je marche en pleine conscience de leur ressentir. Que suis-je alors ? Où est le «moi » dans ce flux nébuleux et contingent ?
- Un instant, « je » peux croire
que le moi est dans cet « effort » qui me fait ramener mon attention
vagabonde sur l'air qui entre et sort de mes narines. Mais, je me prends vite
conscience que cette concentration n'est elle-même qu'un contenu ! D'où vient-il ce « choix » que je fais de
méditer ? D'où vient-elle cette technique Anapana que
j'applique à ma posture de méditation ?
- En sondant davantage, je m'aperçois
qu'elle s'apparente à une sorte de «programme » (neuropsychologique)
des plus basiques, doté d'une seule instruction : « conserve ton
attention sur le souffle au niveau de tes narines ». Qui suis-je ? Ce que je pense être ce « moi »
par lequel je me définis ne serait-il en définitive qu'un ensemble de « programmes »,
certes complexes et interdépendants, mais au sein desquels rien ne constitue ce
« noyau infrangible », autonome et indépendant, que l'on nomme « ego » ?
- D'où viennent alors tous ses
« programmes » ? D'où viennent l'attrait, la volonté et l'envie,
de méditer ? M'ont-t-ils également été transmis, comme la technique Anapana,
par un tiers (enseignement, lecture, etc.) et/ou par une influence inconsciente,
comme autant de stimuli d'action ?
- A mesure que je poursuis mon
investigation, ce qui fait de moi une personne s'évapore progressivement... Tandis
que je me réduis à une volonté diffuse, j'espère encore que le fait d'en
être le témoin (conscient) constitue le dernier bastion dans lequel réside le
« moi ». Une question m'accompagne au terme de la méditation. Si
l'ensemble des programmes qui constituent ma psyché contiennent un programme
dont la fonction est d'effectuer un « retour » sur son (propre)
fonctionnement, cela peut-il suffire à me percevoir moi-même ?
Qu'est-ce que le « moi » ? Qui est, véritablement, ce « moi » dès lors que ma conscience est, à elle-même, son propre contenant et son propre contenu ? Y-a-t-il quelque chose en « moi » qui a l'idée de méditer où le mème de cette idée m'est-il inspiré par la « foule des autres » ? Y-a-t-il quelque chose en « moi » qui fait « l'effort juste » de méditer s'il n'y a rien en moi qui meut ma volonté autre que des « programmes » auto exécutables, rien qui ne soit doté de la faculté de libre-arbitre qui puisse décider et agir en son nom propre ?
Le Védanta affirme l'existence d'un quelque chose « au-delà » de l'illusion phénoménologique du « je ». Le Bouddhisme réfute qu'il s'agisse d'une ego-entité et évoque une « vacuité » pure de toutes influences, mais ô combien difficile à conceptualiser... « Quand tu auras compris la dissolution de toutes les formations (samskâras) [et conséquemment de toutes les dénominations], tu comprendras cela qui n'est pas formé » BB-125.
Comment la conscience pourrait-elle réaliser sa (propre) non-existence ? Comment le « fait d'être conscient » peut-il percer sa propre illusion sans disparaître simultanément de la révélation du « fait d'être non-existant » ? Et comment quoi que ce soit peut-il être révélé à ce qui n'est qu'une illusion ?
Pour résoudre ce paradoxe, le Védanta infère, par la « révélation-libération », l'existence d'un en-soi (atman) immuable, autonome et indépendant, essence de la conscience qui, dans son incarnation (jivatman) est le spectateur subjugué par la magie de l'illusion du spectacle à laquelle il succombe dans l'ignorance de sa véritable nature.
« Si l'esprit est composé, comment peut-il être amené à cet état de vide dans lequel il n'y a plus qu'unité ? » BB-105.
La magie du prestidigitateur provient de l'absence de véritable magie. La « magie du mystère » de la conscience réside dans la capacité d'un agrégat composite, impermanent et temporaire à discerner sa propre artificialité, à percevoir sa «vacuité», soit le vide d'essence nouménale de son être, « par-delà » son illusion phénoménologique.
La Connaissance ne résulte pas d'une intellection rationnelle. Elle est le fait d'une intuition sensible, de la « Vue pénétrante » qui amène la conscience à faire l'expérience de « l'au-delà du par-delà » de sa propre phénoménologie. Sur ce point, le Védanta a raison. La Réalité de la tasse demeure invisible tant que nous ne comprenons pas que la raison pour laquelle nous ne pouvons pas la voir immergée est la même que celle qui nous fait la voir émergée ! En d'autres termes, la manifestation (ce qui est observé et supputé) est le reflet de l'ignorance du fait que l'être est vide d'essence (d'en-soi).
Le tour de magie de la tasse reconstituée réunit trois éléments : une onde, un milieu, un matériau ; qui sont les trois « dimensions » de l'expérience du réel apparent : l'observateur, l'observation, l'(objet) observé. L'observateur est un point de vue relatif aux conditions d'observation dont l'interaction est déterminante de la forme de ce qui est observé. « Ceci étant, cela surgit ; Il n'y a point de réelle production, il n'y a qu'interdépendance » ESBT-54.
Le connaisseur, c'est la lumière. Le connaissable est relatif à sa direction et à sa vitesse. Le connu est l'angle résultant. Ce que nous voyons est un résultat et ce qu'il nous est possible de connaître, un point de vue. Le connu revêt la forme de notre perception. La Réalité derrière « l'objet » (si tant est qu'elle existe) nous est inaccessible, inconcevable. Ce n'est pas qu'elle soit hors de portée de notre connais(sens), seul «existe » le réel apparent, descriptible dans le langage relatif à la sphère de notre ordre d'être « dans laquelle nous vivons, qui constitue notre monde (...) créée par l'étendue et la diversité des contacts de nos sens » CT-12.
Voir la tasse (ré)apparaître est magique, mais voir ce qui n'existe pas en-soi l'est autant ! Le « passer par-delà » du postulat et de l'expérience cognitive de la réalité apparente, telle que définie par le Prâjñapâramitâ comme « allée par-delà et au-delà du par-delà » CT-8, c'est voir derrière l'illusion subjective qu'il n'existe ni objet, ni personne. Pour passer « par-delà », il y a à discerner les constantes[i] du contingent. « Le vide, la non-existence sont perçus après avoir examiné et analysé tous les dharmas (éléments de l'existence, phénomènes) reconnus comme impermanents et dépourvus de soi » BB-122.
Pour atteindre la « connaissance (bodhi) transcendante », le Bodhisattva doit pratiquer les vertus. Au nombre d'entre elles figure le don « sans qu'il croie à la réalité d'une substance absolue, non composée » CT-34 qui les constitue en leur essence, lui et celui à qui il donne. « Le donneur est un agrégat transitoire d'éléments mu par l'action de forces momentanées (...) par lequel de multiples causes enchevêtrées opèrent le transfert à un autre groupe d'éléments d'objets inconsistants (...) il n'y a ni possesseur, ni chose possédée, ni donneur, ni récipient du don, ni objet donné » CT-34.
Il n'y a ni observateur, ni observation, ni objet observé indépendant. Un « état de conscience » est l'expérience phénoménologique de la synergie d'influences (conditionnées et conditionnant) dont la manifestation adopte la perspective du triptyque « connaisseur, connaissable et connu ». L'ego né de l'identification au point de vue de spectateur, l'observateur absorbé par l'objet de sa concentration jusqu'à occulter son aperception, le contemplateur confondu dans l'objet observé jusqu'à la translation de leur position (« l'observé-observant l'observateur-observé »), sont des formes singulières, phénoménales, de la vacuité.

I.50.2 - Unité corps-esprit
- Installé
dans la posture de méditation, enveloppé par l'obscurité, enclos dans le
silence, je me focalise sur l'air qui entre et sort de mes narines. J'expire
longuement et je me laisse inspiré naturellement. J'approfondis le voyage de ma
respiration dans les profondeurs de mon corps à mesure que je me calle sur les
battements lancinants de son rythme. Ma conscience s'expand dans l'étendue du
silence. Je sens mes sens à l'affût du moindre stimulus.
- Des
images apparaissent et disparaissent, suite sans logique, mélange sans cohésion.
Comme dans un rêve semi éveillé, j'observe ce défilé onirique. Quelle en est la
raison ? Où en est le sens ? Je rebondis sur ces visions si fugaces que
j'en oublie le contenu aussitôt revenu à mon souffle. Et le cycle recommence.
D'abord de longs instants sans durée où je ne fais qu'un avec ma respiration.
Puis le silence m'absorbe, mon assise me déplace et les pensées resurgissent à
mesure d'un relâchement imperceptible.
- Des images
apparaissent, discontinues et disparates, stimuli fantomatiques d'une
sensorialité évanescente. Beaucoup disparaissent aussitôt trop légères pour
fixer mon attention, d'autres plus intenses la saisissent le temps d'un instant
comme pour m'inciter à en noter l'impression, toutes s'évaporent lorsque je
reviens à ma respiration. Pourquoi cette différence ? Ai-je été plus impressionné par
ce que j'ai pu voir, entendre ou ressentir la veille ? Je sais
en avoir vu certaines, mais j'ignore pourquoi d'autres m'apparaissent. Je ne
sais même pas si elles sont issues de ma mémoire ou de mon imaginaire. Je me
fais la réflexion d'être un télépathe. Je capte des contenus diffus sans en
connaître la source, ni la raison de l'émission, ni même s'il y en a une !
- Soudain,
je sens mon corps osciller insensiblement « dans le temps » où une image
de l'océan envahit mon champ de vision. Elle est si claire et détaillée, d'un réaliste
si précis que j'ai l'impression d'être littéralement, là, devant ces vagues qui
se propagent sur la surface liquide d'un bleu profond... Les deux perceptions
sont si couplées l'une à l'autre que je suis incapable de dire qui, des vagues
de ma respiration ou de l'image de l'océan, a inspiré l'autre...
- L'idée de
la télépathie me questionne à nouveau. Y a-t-il quelque chose en moi qui cherche à « détecter »
la source de ces émissions ? J'ai l'impression qu'une partie intangible de
« moi » (qui n'est pas totalement « moi », ce
« moi » à la première personne duquel je parle) veut comprendre et
n'a de cesse de savoir. Je me rappelle la « forêt magique » lors de
mon trek au Népal, le sentiment d'être observé et le raisonnement au terme
duquel j'avais conclu qu'il s'agissait en fait de ma propre conscience
s'observant elle-même (l'observé-observant
l'observateur-observé). Peut-être y a-t-il une partie de « moi » qui ignore ce
que fait l'autre et réciproquement ?
- Le
cerveau produit des pensées en permanence. Celles-ci ne naissent pas au moment
où elles surgissent, comme un véhicule en déplacement n'est pas créé à
l'instant où mon oreille capte le bruit de son moteur ni ne disparaît lorsqu'il
est hors de portée de mon audition. Pourtant, lorsque je marche dans la rue, je
«choisis » d'entendre les bruits de la circulation. Si je suis plongé
dans mes pensées, je n'entends pas ce qui m'entoure alors que si je marche en
pleine conscience, je ne fais plus qu'un avec le flux sensoriel. Y a-t-il une partie de
«moi » qui donne à saisir ce dont l'autre est consciente ?
- Je
« choisis » de revenir à mon souffle et ses tergiversations
s'estompent. Lorsqu'elles s'imposent à nouveau est-ce toujours
« moi » qui en cherche la cause où quelque chose en
« moi » mu par une intarissable soif de savoir ?
Au sortir de la méditation, je formalise l'explication qui s'est esquissée à mon esprit. Si la personne n'est pas une ego-entité, mais le produit d'un ensemble de « programmes neuropsychologiques », dont certains fonctionnent de manière automatique, et si la conscience elle-même est un « programme », se pourrait-il que du fait de leurs niveaux relatifs (de leur « sphère de réalité » respective) tous deux s'ignorent mutuellement ?
Je suis conscient d'exister, mais je n'ai aucune (a)perception de la manière dont j'en ai conscience. J'ignore comment mon cerveau me « fabrique » ! Comment quelque chose inconscient de sa propre existence peut-il produire quelque chose capable de se savoir « conscient d'exister » ? L'inverse l'est tout autant. Comment le cerveau sait-il «savoir » qu'il produit la conscience ? Celle-ci ne lui apparaît-elle pas comme une sensation de « présence diffuse » qui l'observe à travers une « forêt » de pensées ?
Le cerveau est une boite noire. Il ne connaît le monde que par l'intermédiaire des données sensorielles à partir desquelles il construit une représentation de la réalité (la réalité « telle qu'elle est » demeurant inaccessible). Ne peut-il en être de même avec ce « quelque chose » que notre degré de conscience permet de qualifier de « conscience», mais dont le cerveau ne sait ni où elle se trouve, ni ce qu'elle est vraiment hormis une ombre indicible d'un autre plan de réalité sur son propre fonctionnement ?
Comment le cerveau s'y prend-t-il pour sonder cet inconnu ? Un radar envoie des ondes qui balaient l'espace aérien et dessinent la forme de l'objet qui les réfléchit. Les pensées seraient-elles l'équivalent d'un « radar mental » ? La manière dont nous y réagissons permettrait au cerveau de se former une représentation de cette autre réalité, mais également d'agir sur elle en retour. Ce qui expliquerait par là-même le pouvoir d'obsession de nos pensées...
En nous laissant entraîner dans leurs rondes, nous donnons au cerveau une image qui en est le reflet. « Nous devenons nos pensées ». Et puisque le reflet correspond à l'objet, le cerveau y répond en nous renvoyant à nouveau les mêmes pensées ! S'ensuit un cercle vicieux. Nous nous piégeons nous-mêmes dans les mailles de nos pensées. Mais, que se passe-t-il si nous « choisissons » de méditer en focalisant notre attention sur la respiration ?
Lorsque les pensées se perdent dans le silence sans limite et la durée sans fin de la conscience « pure » (vide de tout contenu de pensées), elles ne renvoient rien, hormis l'écho de l'espace infini et de la conscience infinie. « Il n'y a rien, là (...) la région du vide - âyatana, la demeure, le siège interne, l'entrée « site de perception sensorielle ou de la pensée » GHUET - où rien n'existe » BB-121.
Dès lors, le fonctionnement du cerveau bascule du « mode action » (stimulé par les ondes alpha) au « mode méditatif » (caractérisé par les ondes thêta). La paix et la sérénité s'installent avec la « cessation des fluctuations du mental » (nirvana ou samadhi). Cerveau et conscience s'alignent et la conscience morcelée par les pensées recouvre l'unité du corps-esprit.

I.50.3 - La sensation du présent
- Je
commence une nouvelle séance de méditation avec un samkalpa (une intention),
celle « d'observer mon attention ». Que se passe-t-il lorsque je me concentrer sur Anapana ? A
l'inspire, je dilate mes narines pour chercher à aspirer plus d'air, comme pour
m'emplir d'une bonne odeur. L'expire est plus difficile à suivre. J'observe le
déroulé du souffle pendant quelques instants, puis j'augmente la longueur des
expire et je me laisse inspirer...
- Je
maintiens mon « effort de volonté », du moins je crois le maintenir
jusqu'à ce que je m'aperçoive divaguant dans l'imaginaire. C'est comme lorsque
la lumière du jour baisse progressivement puis que d'un seul coup l'obscurité est
là, comme si le temps avait sauté des unités dans son décompte. De la sensation
aux images évanescentes, le glissement est imperceptible. Je reviens à mon
souffle en faisant l'effort accru de me (re)concentrer...
- Subjectivement,
le temps où ma focale reste centrée sur Anapana me paraît cette fois-ci plus
long, mais je suis à nouveau distrait, toujours à mon insu, sans pouvoir dire à
quel « moment » je décroche. Comment se fait-il que je ne puisse rester concentré sur ma
respiration ?
- J'exclus
le manque de pratique, car je pense qu'il n'est pas en question et j'écarte les
pensées vagabondes, qui me semblent être une conséquence plutôt qu'une cause...
J'ai l'intime conviction que le problème se situe dans la capacité à me « représenter »
l'objet de ma concentration. Je suis tenté de changer de focale, les paupières fermées
de fixer un point entre les deux yeux au-dessus des sourcils, le troisième œil.
La tension exercée sur le nerf optique induit un silence et un vide mental plus
« persistant ».
- Je me
ravise. Le challenge n'en est pas plus grand avec Anapana. Je prends alors
conscience que plus je fais « l'effort » de fixer mon attention sur
la sensation, plus j'essaie de me la « représenter » au lieu de la
« ressentir » ! Anapana est si subtile que je ne sais pas où s'arrête
la sensation et où commence la représentation ? Mais peut-être n'y a-t-il
pas de sensation qui ne soit en elle-même une représentation ?
- La
perception est déjà un « donné représenté », non une donnée brute. Ce
que mon cerveau me donne à saisir du monde est une construction. Si la sensation est une représentation,
elle ne diffère de mes pensées (qui sont par nature des représentations) que par leur « mode d'induction ».
La sensation est induite par le « monde extérieur », les pensées
le sont par mon « monde intérieur » - l'univers et l'imaginaire sont
aussi réels l'un que l'autre en regard du « pouvoir d'efficience »
propre à leur sphère d'influence -. « Où est la
sensation, la perception en soi ? Ce sont ces caractéristiques que nous percevons, non une chose
en soi. Celle-ci est inconcevable » CT-78.
- Si donc je ne parviens pas à conserver mon
attention sur Anapana, c'est parce que ma sensation, étant une représentation,
induit un glissement naturel avec mes pensées. Il
existe un continuum entre le monde sensible et imaginaire. Entre la forme-sensible et
la forme-imaginaire, toutes deux mentales, comment atteindre la « non-forme » ?
Comment passer « par-delà » la forme pour atteindre le Vide au-delà
de toute forme ?
- En
revenant à Anapana, l'enchaînement répétitif de mes inspires et de mes expires
m'apparaît comme un mantra. Sans mot, ni son, ce « mantra du souffle
pur » - dont je me surprends à attendre le bruit comme le son de l'océan
ou l'écho de la respiration ujjayi -, revêt un caractère mécanique et pourtant si
« vivant » par l'éclairage que lui donne la concentration focale de
ma conscience. Le moment présent se révèle alors dans toute sa simplicité. Mais qu'en est-il de sa nature ? Le « moment présent » appartient-il lui aussi de l'ordre du
représenté ou est-il « au-delà » de toute forme ?
- En me
(re)concentrant sur ma respiration, je lui donne plus d'ampleur. J'étires mon
souffle dans toutes les parties de mon corps, comme si j'inspirais l'air qui
entre dans mes narines avec les muscles de mes jambes, de mon dos, de mes bras,
comment si j'expirais depuis les moindres recoins de ma posture. Puis, je
diminue la focale de mon attention jusqu'à la réduire uniquement à mes narines.
Je reviens à Anapana.
- A
l'épicentre de cet instant, la « sensation du présent » m'envahit,
chasse toute image et toute pensée. Il n'y a rien d'autre que le moment présent,
le silence dans lequel je baigne, l'obscurité de la pièce où je me trouve, mon
assise. Ce n'est pas le vide, ce n'est pas non plus l'absence de forme, c'est la
simple « présence de l'instant ». Je me laisse envahir tout entier en
elle...
- Pour ce
que peut valoir la conscience que j'en ai, cette sensation de « l'ici et
maintenant » me paraît si tangible et si immanente que je ne peux,
indubitablement, douter de sa réalité. Pourtant, je ne peux affirmer, au risque
de me tromper, que le moment présent est au-delà de toute forme. L'intime
conviction de son caractère « réaliste » n'est pas probant. Elle
n'est peut-être que la manière (ou la stratégie cérébrale) qui me permet de différencier,
implicitement, l'extérieur de l'intérieur, non une distinction d'espèce.
- Ce dont
je suis sûr en ce moment précis, c'est que la question n'a aucune importance. Seul
compte « ici et maintenant », au-delà de toute action, au-delà même
du « fait d'être ». A sa manière, que j'ignore et dont je ne me
soucie pas, à cet instant le moment présent prime sur tout le reste. Il dépasse
la forme et la non-forme, l'être et le non-être. Il est félicité...
Le moment présent, dans lequel je prends conscience de moi, est fait de la création et de la destruction simultanées d'« éclairs séparés qui se succèdent à des intervalles si minimes qu'ils sont à peu près inexistants » ESBT-28. Le présent, qui surgit dans l'infiniment bref instant où il disparaît, n'est « ni le même, ni différent ». Comment la conscience que j'ai de « moi » peut-elle être stable alors qu'elle se fonde sur ce qui change constamment ?
L'imbrication temporelle de « la vie et de la mort » au cœur infinitésimal de l'instant présent est si étroite qu'il est impossible de dire lequel est la cause de l'autre, « causes et effets s'engendrent sans que le parent-cause puisse connaître sa progéniture-effet car il disparaît tandis que celle-ci surgit, c'est sa disparition elle-même qui constitue son effet » ESBT-65. La disparition d'une particule virtuelle ne précède pas son apparition fut-ce de la longueur du « temps de Planck » - limite physique de la localité, en deçà une mesure donne un résultat nul et la notion d'espace-temps perd toute concevabilité[ii] -.
Au niveau quantique, la « flèche du temps » n'a plus cours. Le temps peut circuler du futur vers le passé comme du passé vers le futur. La disparition devient causale de l'apparition ! Une « particule virtuelle » peut disparaître avant d'exister(ou sans avoir même à exister) ! « Il faut dépasser l'idée de l'être comme celle du non-être dit Nâgârjuna » ESBT-81. Dans la vacuité, il ne se produit aucun enchaînement, l'être coïncide avec le non-être. Peut-être ne peut-on pas dépasser la forme et la non-forme ? Peut-être faut-il faire du vide la forme ? « La forme est le vide et le vide est la forme (...) En dehors du vide il n'y a pas de forme et en dehors de la forme pas de vide » ESBT-118.

I.50.4 - Entre les interstices
- Je
commence une autre séance de méditation. Deux intentions m'habitent :
l'instant présent et la forme du vide. Mais, ne s'agit-il pas de la même chose
ou comment atteindre
le vide sans forme au cœur du moment présent ?
- Je me
concentre. D'abord sur le silence, dont la profondeur est égale. Puis sur
l'obscurité, dont la surface est sans fond. Sur ma posture ensuite, dont
l'immobilité est mesurée. Puis mon attention se pose sur ma respiration, sur
l'air qui entre et sort de mes narines dans un flux régulier et constant. J'inspire
naturellement, j'expire longuement. J'observe, les similarités, les différences,
«ce qui se passe en moi ». J'englobe le silence, l'obscurité, ma
posture et ma respiration dans le même ensemble et toujours j'observe « ce
qu'il se passe en moi ». L'observation de ma respiration se dégage du lot...
- J'éprouve
un ressenti plus grand, plus intense, plus vrai de l'instant. Le moment présent
apparaît avec évidence. Je m'y installe. Je ne suis plus un observateur, je ne
fais plus qu'un avec l'objet de ma concentration. Puis (comme durant toute
méditation), mon attention se délite et se relâche. Lorsque je m'en aperçois une
nouvelle intention surgit. Qu'est-ce qui (en moi) « fait l'effort » de
revenir à la respiration ?
- Pendant
les instants suivants, durant lesquels mon attention se déplace alternativement
de ma respiration coordonnée à des images surgissant en ordre dispersé, de l'harmonie
du moment présent au rythme désynchronisé du souffle, j'observe l'observateur. Selon
que je reste ou non concentré, mon souffle varie. Je respire au rythme des
fluctuations de l'imaginaire ou j'inspire et j'expire consciemment à la mesure
du moment présent...
- Je continue
d'observer l'observateur. Tantôt je disparais emporté sous les vagues des
pensées, tantôt je réapparais sur l'étendue plane de l'instant. A la fois
témoin et acteur, j'assiste et je prends part à ce jeu de cache-cache qui me
fait rapidement perdre le sens de la réalité. Est-ce l'observateur qui est en alternance « caché et
découvert » où ses « apparitions-disparitions » sont-elles de
véritables « créations-dissolutions » ?
- Je scrute
les interstices. Un instant, j'ai l'impression d'être occulté derrière un mur
d'images éparpillées et chaotiques qui laissent deviner ma
« présence » à travers les espaces non couverts comme entre les
créneaux d'un château-fort. L'instant suivant, j'ai l'impression de
(ré)apparaître sur le devant de la scène lorsque le voile de ma phénoménologie
se lève et se dissipe. Mais, je ne saurais dire si je « passe »
véritablement du second au premier plan ou si je me mets à
« exister » seulement à partir de ce moment-là ! Y a-t-il quelque chose qui
(en moi) « fait l'effort » de revenir à la respiration où est-ce
l'attention portée à la respiration (hors de toute notion d'ego) qui est
constitutive de la perception du « moi » qui se forme en retour ?
- Je me rappelle alors que « le temps psychologique fonctionne à l'inverse de celui de l'horloge[iii] ». Cette « antidatation » inverse l'ordre dans lequel nous avons l'impression que se produisent certains processus mentaux de sorte à nous croyons en être les auteurs. « Le désir de l'autre entraîne le déclenchement de mon désir, il entraîne aussi la formation du moi. C'est le désir qui engendre le moi par son mouvement. Sans le désir, né en miroir, nous n'existerions tout simplement pas en tant que personne[iv] ».
- Je
reviens au moment présent et j'observe. J'observe le moment présent et je
m'observe « moi observant le moment présent ». S'il n'y a pas d'ego d'où
vient que « je » puisse percevoir le « moment présent » ?
Si rien n'a d'en-soi le «moment présent » n'est pas une
réalité autonome et indépendante. Le
moment présent n'a de réalité (pas seulement de pouvoir d'efficience) qu'en
tant que je «me » donne conscience en lui donnant à exister !
- Les
derniers instants de cette méditation s'égrènent au rythme de ma respiration.
Je m'absorbe dans la concentration du moment présent d'une manière de plus
en plus lucide. Il n'y a rien (en moi) qui fait « l'effort » de
revenir à la respiration pour coïncider avec le présent de ma conscience.
Je deviens présent à moi-même à travers le moment présent de ma
respiration. L'un surgit de l'autre comme à la fois sa cause et sa conséquence...
Ce « prēsent » n'est pas temporel, ni physique. Ce n'est pas « l'ici » que je perçois dans l'étendue du silence et de l'obscurité qui m'enveloppent, ni la position locale de mon corps que la pesanteur me fait ressentir via la proprioception de ma posture. Ce n'est pas non plus le « maintenant » de mon horloge biologique interne, synchronisée sur le rythme circadien de la succession du jour et de la nuit.
Ce « moment prēsent » n'est pas tissé par ma représentation comme l'est l'instant local et causal. Il est au-delà de toute représentation, « par-delà » tout contenu phénoménologique. Je ne peux toutefois y « accéder » que par l'entremise de la perception du présent temporel, comme un saut quantique d'un niveau de réalité à un autre.
Lorsque je suis au seuil de cette « porte d'entrée » (de ce pas énergétique), ce n'est pas un « moi » autonome et indépendant, immuable et éternel, sied au-delà, qui reflète la réalité nouménale du « moment prēsent » dans lequel il est établi par essence.
Lorsque je deviens « prēsent », ma conscience est un flux phénoménologique cohérent, homogène et unifié, non plus un flot fragmenté, chaotique et aléatoire de l'imaginaire mental. Leprésent, séquentiel et répétitif, est la forme extérieure manifestée de cette conscience.
Ce mōment est « éternel » au sens où il n'a ni début ni fin. Il ne s'y produit nul surgissement, ni apparition et disparition (« naissance et mort » dans le lexique bouddhiste) d'événements phénoménologiques.
Ainsi, « L'arrêt des fluctuations du mental » - le samâdhi du yoga et le nirvana bouddhiste - n'est pas la caractéristique de l'état de conscience d'une ego-entité transcendante, mais la « transition d'état » d'un flux phénoménologique fragmenté à un flux unifié, le « moment prēsent » de la Conscience, au-delà de toute représentation et de tout ressenti subjectif (égocentré).

I.50.5 - Le mouvement immobile
- Lors de la méditation suivante, je reste
davantage prēsent au moment. Dans les derniers instants un
« événement », éphémère et indicible, se produit. Au présent de ma
posture, qui ouvre sur le prēsent de l'unité de ma conscience, se superpose
« l'image de moi dans la posture ». Est-ce une représentation,
mais dans ce cas pourquoi ne se substitue-t-elle pas comme toute divagation à
l'objet de ma concentration ? Ou est-ce un effet du prēsent, mais alors
comment pourrait-il se « dédoubler » tout en restant unifié ?
- A la question dualiste de « qui fait l'effort de revenir à la concentration ? »,
le point de vue moniste demande « en quoi
consiste cet effort ? ». Le moment présent se distingue
des divagations du mental en ce que l'objet de l'attention est « appelé »
à la conscience alors que le contenu de la phénoménologie imaginaire
« s'impose » de lui-même (sans principe agissant). D'où vient dès lors la superposition où l'enchâssement - volatil, car il m'échappe à mesure
que je cherche à en préciser la vision - de
« (ce qui m'est apparu comme) la représentation
de moi dans la posture dans la conscience de ma posture » ?
- Qu'es-ce qui fait que les
productions de l'imaginaire mental surgissant au cours d'une méditation sont
toujours animées d'un mouvement ? J'observe qu'à chaque méditation, ce qui me fait relâcher mon attention n'est jamais une image fixe. Ni
paysage, ni portrait, ni statue, ni objet immobile, toujours quelque chose qui
se déplace, entraîné par un courant permanent. « Ce dont je suis le
spectacle » (en me coulant dans son flot) avant d'en devenir le spectateur
- dès que, conscient de m'être laissé emporté par mon mental, je reviens à mon
souffle - me semble avoir pris naissance dans les profondeurs indicibles de ma
psyché avant d'émerger au seuil de ma conscience lorsque son énergie cinétique
est devenue suffisante pour le franchir...
- Je me rends compte également que ce qui me
fait prendre conscience de ma divagation, c'est l'immobile, non pas le présent
local, mais l'arrêt et l'absence de mouvement. Ce peut être l'immobilité du
silence ou la fixité de l'obscurité, l'immobilité de ma posture ou le ralentit
de ma respiration. Mais, dès que je porte mon attention sur plus d'un
« objet » à la fois (ou que le silence soit rompu par un bruit ou que
l'obscurité ne soit plus homogène), un mouvement se crée et, à peine en ai-je
conscience, que je suis à nouveau emporté par le courant de l'imaginaire !
Mais, si le mouvement entraîne le mental, pourquoi
choisir la respiration (un flux dynamique !) comme objet
d'attention ?
- J'observe le flux de mes pensées et
l'évidence surgit. La perception de
l'immobilité n'est pas l'opposée de la perception du mouvement, elle en est
constitutive. Le mouvement (que je perçois) est formé par la série de
moments (perçus comme) immobiles accolés les uns aux autres d'une manière
contiguë. Le « mouvement sensible »
naît, à ma conscience, de la succession continue de « moments sensibles »
immobiles, dont les enchaînements sont si rapides - à l'instar de la
création et de la disparition de « particules virtuelles » au niveau
quantique - que je les perçois animés.
- Il m'est (quasi) impossible d'échapper à
mon mental lorsque je me concentre sur le mouvement de ma respiration.
Inévitablement, sa dynamique entraîne celle d'images fantasmatiques. C'est
aussi la raison pour laquelle fixer un point immobile comme le troisième œil
amène à un vide plus profond et (subjectivement) plus durable. La finalité d'Anapana ne me paraît
toutefois pas être de parvenir à décohérer la conscience de la perception du
mouvement, mais à comprendre, par l'investigation de son observation, le
rapport de nature psychologique existant avec l'attention immobile. A cet
instant, je saisis que ce n'est qu'en parvenant (par l'observation) à
comprendre la manière dont mon esprit fonctionne que je parviendrai, par
là-même, à dépasser ses limitations et à demeurer dans l'immobilité de l'objet
de ma concentration, non sujet aux fluctuations de mon imaginaire mental.
- Une vision (une série d'images en
mouvement) surgit alors à ma conscience. Je suis un rocher au milieu d'une
rivière entouré d'un courant puissant. La masse de mon corps m'assure de
résister à l'assaut des flots. Lorsque je focalise mon attention sur mon corps
de pierre, je vois l'eau s'écouler tumultueusement tout autour de moi, mais je
demeure immobile malgré son accélération. Mais, dès que je déplace mon
attention sur le courant, je suis aussitôt emporté et je ne fais plus qu'un
avec les flots...
- Des mots me reviennent en écho. L'esprit
devient un observateur passible du mouvement « en
prolongeant graduellement la durée des périodes où la formation d'idées ne se
produit pas » BB-124. Comment l'immobilité
peut-elle agréger des moments immobiles sans devenir « flux » ?
- S'ils s'enchaînent mentalement, c'est que
ces moments sensibles ne sont pas identiques dans leur contenu perceptuel et la
succession de leurs différences phénoménologiques sera de facto créatrice d'un
mouvement perceptible. Et si tant est qu'ils puissent devenir
réellement « identiques » du point de vue psychologique, le « moment
physique » présentera toujours une différence ne serait-ce que du fait de
« l'éternel retour de l'instant ».
- Einstein a révélé la relativité du temps,
qui ralentit à mesure de l'accélération jusqu'à s'arrêter complètement à la
vitesse de la lumière. L'immobilité
n'est pas (non plus) l'opposé du mouvement physique, mais un « point de
vue » différent (un moment relatif) sur un même phénomène,qui nous rappelle qu'il n'y a pas de
« réalité » indépendante d'un observateur.
- Je suis dans un train en mouvement et je
regarde le paysage, puis les rails. Dans ce moment où le mouvement gomme
les interstices, je ne perçois plus qu'un trait continu presque immobile. Sur l'image
du wagon se superpose celle du rocher au milieu de la rivière. A contre-courant
du flux du devenir de mon mental, j'observe ce mouvement tissé d'immobilité,
dont l'assemblage d'une multitude indicible de moments (locaux) forme une unité
indifférenciée dans laquelle l'observation de l'instant présent (local) fait, ici
et maintenant, place à la prēsence consciente du moment...

I.50.6 - Changer de plan
Entrer dans la posture de méditation et regarder « passer le flot ininterrompu des idées qui se pressent à la suite les unes des autres » BB-124 n'infère pas du caractère ego-entitaire de l'observateur. L'observation attentive me permet-elle d'appréhender l'expérience de « l'absence d'en-soi » ?
- J'inspire naturellement, j'expire
longuement. A chaque inspire, je me concentre sur l'air qui entre par mes
narines, à chaque expire sur l'air qui en sort. Je n'attends pas que mon
attention se relâche, ni de me laisser emporter par des divagations imaginaires
pour « revenir » à la respiration. Je dirige consciemment mon
attention à chaque inspire et à chaque expire. J'observe ma concentration à
l'inspire, j'observe ma concentration à l'expire.
- Les cycles se succèdent. Des images animées surgissent, colorées et intenses. Je reste concentré. Les séquences changent à chaque nouveau cycle. J'observe ma constance. A chaque nouvel inspire, un film original surgit, inattendu, différent du précédente, qui disparaît en un éclair fulgurant à l'expire. Je reste concentré. Les images se succèdent, chatoyantes, fantasmatiques. Si je me laisse emporter, ces prémisses vont m'emporter dans des rêves inimaginables. J'observe ma concentration.
- Le flot ne tarit pas, ma
respiration le nourrit. Chaque inspire fait surgir une image flottante qui
disparaît avec l'inspire. J'observe le passage d'une nuée de rêves dont la
durée éphémère ne dépasse pas la longueur de mon souffle. J'éprouve un sentiment
diffus et océanique. « Je » ne suis
pas ses images, aucune d'elle ni l'ensemble tout en étant « ce qui les
produit ». Ma position d'observateur me fait me « sentir » unitaire et
pourtant je ne « vois » là qu'agrégats ?
Aldous Huxley parlait de notre vision du monde comme le produit du filtrage de la réalité (sensible) par le cerveau. Ce mécanisme qui évite à l'individu « d'être submergés et confus sous cette masse de connaissances en grande partie inutiles et incohérentes (...) ensorcelle son sens de la réalité » : il occulte la véritable portée de nos facultés de perception en nous faisant croire que « le conscient réduit est le seul conscient », que ce que nous voyons est la réalité telle qu'elle est ; il nous fait oublier (ou nous rends incapables de prendre conscience) que « chacun de nous est, en puissance, l'Esprit en Général » AH-PP-27 ; en induisant l'illusion d'un spectateur égocentré autonome, indépendant et individualiste, œuvrant à ses propres intérêts.
C'est une impression curieuse d'être à la fois sur le bord de la rive à regarder une épreuve de natation et, en même temps, d'y participer ! C'est pourtant cela que j'éprouvais, observateur attentif, détaché, calme et serein, baignant dans un flot fantasmagorique de perceptions hallucinées. C'était comme si les fluctuations de mon mental n'avaient pas cessé mais que mon esprit restait imperturbable ! Toutefois, même si la surface de l'océan est agitée par une tempête, ses profondeurs demeurent toujours calmes et silencieuses...
- A
certains moments lors de mes méditations, mon attention est concentrée sur ma
respiration sans contenu phénoménologique. A d'autres moments, je perds la
focale de mon attention emporté par les divagations oniriques de l'imaginaire
mental. A d'autres encore, les deux se superposent et coexistent simultanément
en équilibre. Comment puis-je focaliser
mon attention sur un objet tout en étant balloté par les fluctuations du flux
phénoménologique ?
Si le « moi » n'est pas une ego-entité, je devrais être capable de discerner les faisceaux composant son agrégat, même si je ne peux les dissocier. Mes sens me donnent une perception synthétique du monde. Je vois les couleurs, la profondeur, la perspective, j'entends les aigus, les graves, les basses, je ressens la gravité, le haut, le bas, la position de mon corps, mais je ne peux pas (volontairement) dissocier les éléments de ma perception, abstraire les couleurs, soustraire les aigus, retirer l'apesanteur... Si tout ce que je perçois est synthétique, pourquoi la conscience de soi ne le serait-elle pas aussi ?
Certes, je ne peux pas discerner ses faisceaux, mais la conscience de soi se distingue de la perception sensorielle, car elle est son propre observateur. Un neurochirurgien peut désactiver les aires ou les zones cérébrales spécifiques à la vision des couleurs, à la perception des aigus sur un autre cerveau, mais il ne peut pas désactiver les aires motrices de son propre cerveau tout en continuant de s'opérer lui-même ! Dissocier les faisceaux constitutifs de l'événement phénoménologique du sentiment du moi revient à l'inhiber.
Si tant est que cette dissociation soit possible. En affirmant inconnaissable l'origine de la « Chaîne des origines indépendantes », le bouddhisme n'a-t-il pas voulu réfuter l'idée réductionniste d'un enchâssement sans fin de faisceaux synthétiques à l'intérieur de faisceaux eux-mêmes composites ? Eu égard au principe d'interdépendance, considérer le « moi » comme le dernier « maillon » de cette chaîne est aussi dénué de sens que de lui postuler une origine. Mais, s'il écarte l'idée d'un « aboutissement », il n'exclut toutefois pas la possibilité qu'il puisse être le résultat d'un processus d'émergence...
Postuler que le « sentiment du moi » (la conscience) est un événement émergeant - du maelstrom phénoménologique d'un faisceau de composants (conditionnés et conditionnant) déterminé par le plan inférieur (neuronal) dont il est causalement issu et doté d'un « pouvoir causal » propre à son niveau d'efficience - revient à affirmer possible d'être l'objet synthétique de sa propre observation en tant qu'observateur simulé. Autrement dit, avoir conscience du caractère composite de la conscience ne serait possible qu'à la condition de sortir du référentiel considéré, au sein duquel cette affirmation constitue une « proposition indécidable ». Cette hypothèse suggère qu'un état de conscience fait de vacuité et de félicité peut émaner ou surgir des fluctuations d'un système lorsque les faisceaux de ses constituants enchâssés entrent en état de résonance ou de synchronicité.
Si plusieurs personnes jouent chacune d'un instrument de musique différent, ce sera la cacophonie. Mais, si elles jouent la même partition guidée par un chef d'orchestre, il en résultera harmonie, beauté et émotion. La beauté de la musique symphonique et l'ampleur des sentiments qu'elle fait naître chez ses auditeurs ne résident ni dans l'orchestre, ni dans les instruments qui le composent, ni dans leurs composants, ni dans leurs matériaux... La beauté et l'émotion de la musique sont une « émanation » sur un autre plan de réalité, qu'une analyse réductionniste de ce qui les produit ne permet pas d'isoler. Leur caractère transcende les faisceaux de déterminants composites et s'abstrait de la chaîne de leur origine causale. Il faut changer de niveau de réalité pour les saisir en effectuant (comme eux) un saut qualitatif.
Deux sons de même fréquence peuvent aussi s'annuler par « opposition de phase ». Les vibrations ne disparaissent pas pour autant, elles sont toujours « là », sans quoi les sons ne pourraient s'annuler mutuellement ! Deux systèmes philosophiques se télescopent à nouveau ici. L'un prétend qu'il (pré)existe un orchestre dont chaque membre peut jouer à sa guise, leurs éléments se ramenant au Tout dont ils font partie. L'unité sera, ici, un en-soi immanent pouvant revêtir de multiples formes. L'autre système avancera que l'orchestre est un « ensemble de musiciens » (et chacun d'eux un agrégat d'éléments physiques et psychiques) dénué d'en-soi, dont la forme dépend de son comportement, c'est-à-dire de sa non-congruence ou de sa synergie.
La « transition » d'état d'un système ne constitue pas un « retour » à un état d'unité, mais son émergence par sa déli(vr)ance sur un autre plan. Sous cet angle, le silence et la félicité ne sont pas la conséquence de « l'arrêt des fluctuations du mental » et des gémissements de souffrance du « moi », ni le discernement et la connaissance la conséquence de la libération de l'état de confusion et d'ignorance induit par l'identification à l'ego.
La vacuité émane d'un changement de modularité de la conscience, dans laquelle la lucidité surgit de l'harmonie des phases dans l'intuition expérientielle de la prēsence.
La conscience sait « ce qu'elle n'est pas » - « Je » ne suis pas ses images, aucune d'elle ni l'ensemble - et « ce qu'elle est » -tout en étant « ce qui les produit » - lorsque, à son éveil à un autre plan de conscience (samâdhi et nirvana), « au-delà » de l'être et « par-delà » le non-être, la conscience devient à elle-même sa propre Connaissance.

I.50.7 - L'instrument de conscience
- Bien que
le silence règne tôt le matin, je fais l'essai d'utiliser des bouchons
d'oreille pour méditer. Le silence est plus profond, ma respiration amplifiée. Elle
produit le bruit de l'océan, régulier et hypnotique. Je perçois le son, à la
tonalité légèrement aigüe, de l'air plus frais qui entre dans mes narines et qui
ressort, plus chaud, dans les tons graves. La profondeur du silence facilite le
retrait des sens (pratyhara). Tandis que l'écho de mon souffle diminue, mes
battements cardiaques se font plus nets. Je reviens à ma respiration et je me demande
à nouveau « qui fait cet effort » de (re)concentration ?
- C'est par
la force de l'évidence que je perçois le caractère composite du flux d'images
mentales, aléatoires et spontanées, surgissant à ma conscience. Le bouddhisme affirme que ma
conscience n'est pas autogène, mais comment en faire l'expérience ? Comment
est-ce que je peux être, tantôt « extérieur » au spectacle, tantôt me
« confondre » avec le spectacle lui-même ?
- Le
Védanta affirme que ma conscience est un en-soi. Or, le fait qu'elle puisse englober
des objets « différents » et m'en donner l'expérience à chaque fois
spécifique suggère que mon champ de conscience ne peut être homogène ! Comment quelque chose
d'homogène pourrait-il saisir ce qui est disparate ?
- Je
« reviens » à ma concentration lorsque je « prends
conscience » que mon attention « s'est déportée » de ma
respiration, « emportée » par un contenu mental imaginaire. Mais, cette
impression est-elle fondée ? Puis-je en inférer que mon attention est
détournée par une « force » extérieure ? Ne serait-ce pas plutôt ma
conscience qui « modifie » sa focale avec pour effet d'induire, par ce
changement même, le réalignement du spectacle sur le spectateur ?
- Mon
attention est pareille à ma respiration, en mouvement constant. J'inspire et
(la sensation de) mon inspiration devient l'objet de mon attention. J'expire et
(le ressenti de) mon expiration devient le nouvel objet de mon attention.
J'inspire longuement et ma concentration s'établit dans le silence du mental.
J'expire lentement et ma conscience se (dé)porte - en-deçà de tout effort
volontaire - vers (ou à la recherche) d'autres objets mentaux...
- Les
étoiles n'occupent pas une position fixe dans le ciel nocturne. Elles se
déplacent et, par le fait, leur distance à ma position relative change en
permanence. Si je veux observer une étoile avec un télescope, je dois
constamment régler la mise au point pour qu'elle reste dans le champ de l'objectif
et que son image demeure nette. C'est parce que le télescope est un instrument
composite, qu'un tel réglage est possible.
- L'œil est
également un instrument (d'optique). Mon cerveau est lui-même un autre type
d'instrument, capable de traiter les informations recueillies grâce au
télescope, de les analyser et de les comprendre. Chacun ont leur mode de
fonctionnement propre et sont régis par des lois (et principes) physiques. Mon
cerveau, mes yeux et le télescope, combinés ensemble, constituent un
méta-instrument. Aucun d'eux n'est, en soi, immobile. Si le télescope était
réglé sur une position fixe, je ne pourrais voir qu'une seule partie du ciel,
(qu'elle soit ou non occupée par la trajectoire d'une étoile). Si mon œil n'avait
pas la capacité de mise au point, je ne pourrais pas voir les objets proches et
lointain. Si ma conscience n'était pas, elle aussi, « modulable »,
comment pourrais-je me concentrer sur un objet ?
- J'observe,
en spectateur conscient, le flux de mes réflexions qui s'enchaînent
d'elles-mêmes dans leur raisonnement discursif. Patanjali parle
du « principe de conscience » qu'il différencie de
« l'instrument de conscience » qui, en leur confusion, engendre
l'ignorance-illusion de l'ego, autrement dit le « moi » cette
ego-entité, indépendante et autonome. Les principes de la physique sont
différents de la matière physique, mais ils ne sont pas indépendants de la
nature. Le télescope et l'œil n'utilisent pas seulement des principes
d'optiques, ils en sont les applications concrètes, variées et multiformes. La conscience individuelle, elle-même, n'est
qu'un instrument de cognition qui « exprime » le principe de l'esprit
à travers le substratum du corps.
- Si la conscience est un principe pur, immanent et autogène, sans lequel toute cognition serait impossible, elle ne peut toutefois rien (trans)porter avec elle. Si l'atman conserve des éléments relatifs à son incarnation physique par-delà l'agrégat composite temporaire qu'il forme avec le corps (le jivatman), c'est qu'il est lui-même composé !
- « Rien ne transmigre » d'une re-naissance à une autre ne signifie pas qu'il n'existe pas de « principe de conscience » ego-entitaire, mais son immanence contredit toute forme de conservation de la mémoire des événements vécus relatifs au « je » et n'est que pur principe.
- En quoi ce « principe de conscience » est-il différent des principes d'optique ou des « constantes fondamentales » de la physique ? Que sont ces connaissances sans une instrumentalisation efficiente ?
- Autrement dit, s'il n'y a pas de conscience sans « objet de conscience »,
il n'y a pas de conscience qui ne soit cognition sans être par là-même composite.

I.50.8 - L'intensité du souffle
- En ce
début de quatrième semaine - je médite une heure par jour, cinq jours par
semaine -, alors que je m'installe dans ma posture de méditation, je me
reconnais enclin à une certaine forme de lassitude. Je m'avoue une certaine
préférence aux séances analytiques plutôt que « seulement »
concentratives. Ce matin, je « décide » dès le premier inspire de
laisser faire ma respiration. Je prends conscience que je n'ai, jusqu'à
présent, jamais « véritablement » laisser ma respiration « se
faire toute seule », que je ne me suis jamais « réellement »
installé dans la position de « pur observateur ». Pour cela, il me
faut lâcher-prise, devenir mon propre spectateur, ne rien (chercher) à
contrôler, à commencer par le flux de ma respiration !
- La toute
première chose que j'observe, c'est le rythme de mon souffle et la première
impression qui me vient est l'étonnement. Ma respiration n'est-elle pas un peu
rapide ? Elle accélère encore... Bientôt, je n'ai plus de doute, elle est
en train de s'emballer !!! La fréquence des inspire et des expire augmente
et à mesure la quantité d'air qui entre et sort de mes poumons diminue. L'inquiétude
me gagne. Il me faut me rasséréner sans céder au réflexe de vouloir prendre le
contrôle, sans chercher à apaiser l'émotion croissante... Laisser faire. Ne pas
intervenir. Observer. Observer comme si j'observais un autre que « moi ».
D'ailleurs, puis-je encore parler de « ma » respiration tant la
liberté que je lui laisse m'enlève toute prétention de possession ?
- Je
m'aperçois que les images mentales ne surgissent plus ! Curieusement, je
constate que plus je me concentre sur Anapana et plus je suis distrais de ma
concentration. Et alors même que je me concentre, maintenant, « d'une
autre manière » sur mon souffle, tout objet de distraction s'éclipse...
- Je
continue à observer. Mon inquiétude s'est amoindrie, mais je me demande combien
de temps mon corps pourra tenir ce rythme effréné. Au moment où je me pose la
question, « ma » respiration franchit un second palier en accélérant
encore !!! La durée entre les inspire et les expire est aussi brève que
lorsque le cœur s'emballe dans un sprint. Leur amplitude dépasse largement
celle de mes battements cardiaques. Mais, ce n'est plus un emballement
incontrôlé, c'est un rythme désormais parfaitement cadencé ! Quelque chose
en « moi » a pris le contrôle, « je » lui ai laissé prendre
le contrôle, peut-être même le lui ai-je (délibérément ?) « donné »
au moment où ma crainte laissait place à la curiosité ? Au
moment où je me demandais comment je pouvais respirer avec si peu d'air
qui entrait et sortait de mes poumons à un rythme aussi rapide ?
- Dans ma
position, qui est désormais celle d'un véritable spectateur, j'éprouve un
sentiment diffus. Peut-être n'y a-t-il eu aucun « transfert » de
commande ? Et si je n'étais (et que je n'avais jamais été) rien d'autre
qu'un observateur qui s'hallucine de sa propre illusion de contrôle ?
C'est alors que j'observe le franchissement d'un troisième palier à ma
respiration...
- Le bruit
des inspires et des expires retentit soudain à mes oreilles comme un coup de
tonnerre suivi du souffle brusque d'une tempête. Leur fréquence est toujours
aussi rapide, mais leur amplitude est plus profonde. La quantité d'air inspiré
et expiré a sensiblement augmentée. Le rythme est toujours très soutenu, tel un
halètement - passage de Kapalabathi à Bhastrika, techniques de pranayama
puissantes - tenue sur une très longue durée.
- Au moment
où je me fais cette réflexion, une image surgit à ma conscience. Un reflet de
lumière - « bathi » veut dire brillant en sanscrit - éclaire la
surface de l'océan depuis ses profondeurs. Son éclat augmente d'intensité
jusqu'à faire totalement inverser ma perspective. Je suis désormais sous la
surface et la lumière semble provenir du dessus, puis l'image disparaît...
- Je
franchis alors un quatrième et dernier palier où ma respiration ralentit. Toujours,
je ne (cherche) pas à contrôler. Laisser faire. Observer. Le rythme est
désormais lent, excessivement lent ! Les inspire et expire s'étirent en
des mouvements presque impalpables. Le souffle devient quasi inaudible. Des rétentions
poumons pleins et surtout vides se font spontanées, s'installent et
«habitent » littéralement la durée qui s'allonge beaucoup plus loin que
mon contrôle conscient ne pourrait jamais les mener sans manquer d'air...
- Ici, nulle angoisse de l'asphyxie ne vient me hanter, nul réflexe d'apnée ne cherche à me faire sortir de cet état de quiétude. Ma respiration est longue, profonde, sereine, apaisée comme après un ouragan sur l'océan qui retrouve son calme. Une sensation de bien-être m'envahit tout entier. Je me laisse porter par la douceur du flot. J'habite l'instant en pur observateur. Je n'ai rien à changer, rien à ajouter, rien à extraire, rien à modifier.
- Tout est dans l'état où
il doit être. Je n'ai nul besoin ni nécessité, nulle contrainte ni intérêt
d'imposer ma volonté sur cet état de perfection sans fin. Je n'ai nul désir que
celui d'être et de savourer l'instant, sans effort ni interrogation quant à chercher
à saisir et à connaître la nature du moment présent. Je respire sans avoir à
respirer. J'observe sans avoir à observer. Je suis sans avoir à être.
Etre observateur de soi-même n'est pas chose aisée. La force de l'habitude, le jugement, la peur du lâcher-prise, nous font rechercher le contrôle. Mais le véritable obstacle réside dans la qualité de témoin. Pour être « pur témoin de soi », il faudrait pouvoir se dissocier (littéralement) de soi-même. Or, ce n'est pas quelqu'un d'autre que « j'observe », ni quelque chose d'autre « qui » m'observe. Je suis à la fois observateur et objet de ma propre observation !
Même si je parvenais à (totalement) lâcher-prise, « m'observer » est un acte de conscience. Cette activité psychologique est une activité cérébrale. Je ne puis me détacher de mon cerveau, même si la conscience que j'ai de moi me donne l'impression d'être distinct de mon corps et de constituer une ego-entité autonome et indépendante. Cet observateur « pur » est une illusion phénoménologique, tout comme l'est le « sentiment de moi ».
Lors de cette dernière méditation, j'ai eu (véritablement) l'impression d'avoir lâcher-prise, ma respiration « décidant » d'elle-même de son propre rythme. Pour le Bouddhisme, tout effet à une cause, sans origine connaissable. En y repensant, le second palier (correspondant au passage d'une fréquence « emballée » à une fréquence rythmée), pourrait très bien avoir été influencé par ma propre observation... Comme mon image dans un miroir me permet de rectifier ma posture, être témoin de mon souffle peut le modifier sans même en formuler l'intention ! La conscience jouerait le rôle d'un « miroir » renvoyant un feedback de ma respiration au cerveau - enclos dans la boite noire du crâne sans autre cognition du fonctionnement du corps que le retour d'informations sensorielles -, qui pourrait ainsi en corriger le rythme.
Comme dans un jeu musical entre deux batteurs, tour à tour guide et suiveur, où avec l'accélération, il devient rapidement impossible de discriminer leur rôle (pour une oreille lambda), ma respiration et l'image que ma consciente lui renvoie se sont synchronisés et ont (inter)agis l'un sur l'autre, sans que je n'ai eu à exercer une quelconque forme de volonté, ni que ma qualité de témoin en fut altérée. Le même raisonnement peut s'appliquer à la transition entre le troisième et le quatrième palier, caractérisé par le ralentissement de ma respiration devenue (très) lente et (très) profonde. Vu dans sa globalité, le phénomène aura été, tout du long, en chacune de ses phases, « contrôlé » par mon cerveau et « guidé » par mon observation.
Mais surtout, ce pilotage aura été « inconscient », sans possibilité pour moi d'en identifier la cause. Bien que j'aie eu l'impression de lâcher-prise pendant toute la durée du processus, je ne me suis jamais (totalement) départagé de la sensation « d'exercer » un contrôle coïncidant à mon observation. Je ne saurais dire objectivement si j'observais «seulement » ou si je ne participais pas un (petit) peu en « revenant » au lâcher-prise comme je « ramène » ma concentration sur mon souffle... Ai-je (véritablement) été le témoin impartial de ma respiration ? Mon cerveau a-t-il décidé « seul » de la durée des paliers et du moment des transitions où l'ai-je d'une quelconque manière influencé ?
Je ne suis pas distinct de mon cerveau. « Je » suis à la fois « mon » cerveau et « ma » conscience, l'image que mon cerveau a de lui-même à la travers la conscience que j'ai de moi. Tel le reflet de mon corps dans un miroir, mon aperception est une « projection» émanant d'un « émetteur ».
La conscience ne réside pas dans (les qualités propres de) ce « miroir », car cela reviendrait à affirmer l'existence d'une ego-entité indépendante. La conscience surgit de « l'écho » de l'activité du cerveau, comme le « moment prēsent » (non-local) émane du mouvement imperceptible formé par l'apparition et la disparition successive et spontanée de l'instant (local). Lorsque les mouvements de création et de destruction deviennent si rapides qu'ils se confondent, telle une succession d'éclairs d'énergie fulgurants qui s'évaporent aussitôt formés, quelque chose de nouveau émerge - que les propriétés du niveau inférieur ne saurait totalement expliquer -.
La conscience n'est pas dans le contenu de notre phénoménologie mentale, elle est littéralement ce contenu en tant que produit émergeant de l'activité du cerveau qui «se renvoie à elle-même » en écho. « Tout vijnâna, état de conscience, est produit par des "courant d'actes de pensée" ; chacun a pour causes (...) non pas un noumène, mais l'acte de pensée qui précède immédiatement » DC-29.
La conscience « persiste » toutefois dans les interstices où nulle confection mentale ne se forme, suggérant l'existence « d'autre chose ». Pour autant, l'air peut vibrer sans produire de sons ou sans que nous puissions les entendre. Comment pourrait-il y avoir conscience sans un écho qui ne soit conscient ou sans quelque chose qui en soit conscient ? Nous ne sommes pas « conscients » de ce qui passe en-dessous du seuil de la conscience, mais il s'y produit une activité continuelle. Celle-ci nous est indicible, car elle ne produit simplement pas d'échos phénoménologiques !
Les moments de silence et de vide mental sont-ils des vibrations résiduelles d'échos évanescents ? « Le vijnâna est un aliment, l'esprit se nourrit de ses opérations, il n'est qu'un processus de vijhânas. S'il cessait de s'alimenter ce serait le nirvana ; il s'alimente : d'où la vie et la renaissance » DC-29.
Ces questions sont d'ordre rhétorique. Seule l'expérience de la conscience est connaissance.Sous toutes ses formes, déclinaisons ou états, nous ne pouvons connaître que ce qui relève de l'ordre et de la sphère du relatif. Toute extrapolation procède de la relativité y compris une « Réalité en soi », (individuelle, universelle, absolue). « Pour les mahâyânistes (...) la Réalité exclut à la fois la dualité et la non-dualité ; elle ne peut se concevoir (...) les connaissances que nous pouvons acquérir sont limitées et conditionnées par nos facultés de perception. Toutes nos connaissances sont relatives et tous les objets qu'elles atteignent sont, aussi, relatifs » BB-161. Même la foi, qui s'abstrait de preuve tangible, se revêt du vêtement du relatif. Rien en dehors de l'expérience sensible n'est connaissable. « Inconnaissable est l'Absolu ; connu, il deviendrait relatif » BB-161.
Au cœur du silence de la conscience, si je ressens une « prēsence », puis-je prétendre qu'elle est « réelle » (existant en soi) ou ne serait-ce que le « reflet » déformé de quelque chose de réel ? La sagesse est d'accepter le cadre restreint de ma pensée, de reconnaître les limites de toute doctrine et de celles de la philosophie, le caractère conditionné et conditionnant de toute croyance, de vivre l'expérience de la conscience, sans prétendre vouloir résoudre un mystère, ni faire de ma propre connaissance un absolu.

I.50.9 - Haute sensibilité
- Je prends
plusieurs grandes inspirations et plusieurs grandes expirations. Puis, je
laisse aller mon souffle. J'observe. Ma respiration adopte à nouveau un rythme
en paliers. Cette fois-ci, la succession des inspires et des expires s'accélère
à trois reprises. D'abord longue, leur durée diminue jusqu'à se réduire au staccato
d'un halètement. Puis la machinerie s'enraye comme un vieux moteur qui
pétarade. Ma respiration diminue subitement pour entrer dans un régime de (très
grand) ralenti. Je me décontracte profondément...
- Une
pensée me traverse l'esprit. Je pense aux personnes en état de transe,
entraînées dans des « crises épileptiques » dont (à les croire) elles
ne sont pas les auteurs. Je ne sais toujours pas d'où vient ma respiration en
palier, peut-être des exercices de pranayama que je pratique avant la
méditation ?
- Mais cela
est sans importance dans l'état de quiétude et de bien-être qui m'envahit
lorsque ma respiration entre dans sa phase de grande profondeur. J'observe
comme un « effacement » entre les sensations, à moins que ce ne soit
une « fusion », qui relie en un continuum sans discontinuité
(visible) l'obscurité, le silence, ma posture et ma respiration. Pendant un
instant sans durée, j'ai l'impression d'être tout cela en même temps ! Je
ne distingue plus l'un de l'autre. Où suis-je à cet instant, dans un lieu de
silence obscur ou dans un obscur silence, ancré dans le sol par la gravitation
ou gravitant dans l'espace de ma posture ? Je ne saurais dire si j'ai les
yeux fermés ou ouverts, tant l'extérieur se confond avec l'intérieur, le haut
avec le bas. J'inspire le silence, j'expire la vibration sensitive de mon corps.
Le silence devient son...
- J'entends
les battements de mon cœur plus nettement qu'hier et surtout plus longuement.
Ce bruit de fond ne me quittera (quasiment) pas l'heure durant. Les bouchons
d'oreille doivent y participer, comme une caisse de résonance, ce qui n'empêche
pas à certains moments de ne plus les entendre, comme le tic-tac d'une pendule
qui disparaît puis réapparaît...
- En
diminuant les perturbations sensorielles extérieures et, par le fait, en
amplifiant la profondeur du silence, cet accessoire rend ma concentration plus
intense et plus durable. Il n'y a (presque) plus d'images qui me viennent.
Seule demeure encore la voix clairsemée de ma pensée, locuteur vigilant qui
prend note de chaque moment important. C'est le seul point sur lequel, je n'ai
pas lâcher-prise. Mais, les sensations deviennent si subtiles de jour en jour
que je veux pouvoir conserver une trace mémorielle de l'expérience.
- Pour
autant, cette voix ne vient, en rien, me perturber ou me distraire. Elle est
comme le point de concentration sur le souffle, Anapana, qui demeure tel un
point fixe dans un flot d'images mentales (lorsque celles-ci surgissaient encore
spontanément). J'avoue d'ailleurs ne plus fixer ma focale sur ma respiration.
Le son produit par mes battements cardiaques, désormais de plus en plus fort,
prend le pas comme point de concentration.
- Je
croyais qu'Anapana exigeait une grande sensibilité pour le saisir et ne pas le
laisser s'échapper, mais j'ai constaté qu'il n'empêchait pas l'imaginaire de me
distraire. Je m'aperçois qu'en fixant mon attention sur mes battements
cardiaques, non seulement je parviens à rester plus longtemps concentré sans
aucune perturbation mentale, mais ma sensibilité augmente !
- Je suis
même surpris de constater à quel point celle-ci s'est accentuée. Cela prend
d'abord la forme d'un son qui s'amplifie au niveau de mes oreilles, puis le
battement devient une pulsation toujours localisée dans mes tympans. A mesure
qu'elle s'accentue, la pulsation devient sensible au niveau de ma poitrine. Non
seulement, j'entends battre mon cœur, mais effectivement, je le sens « littéralement »
dans ma poitrine...
- Mon
attention semble désormais captive au point qu'il me semble devoir faire un
« effort conscient » pour l'en détacher ! Mon imaginaire est mis
en retrait, comme endigué derrière un mur imperméable. Je développe une
sensibilité qui m'étonne d'instants en instants. Je perçois soudain un double
battement. Au moment où je m'interroge sur sa provenance, l'évidence surgit.
J'entends et je perçois distinctement l'entrée et la sortie du flux
sanguin ! Ce stimuli, d'une grande subtilité, m'échappe puis revient à
plusieurs reprises. Je le perds ensuite et c'est alors qu'une autre sensation
surgit...
- Nous
avons tous fait l'expérience du ressenti « de ce que cela fait »
lorsque le cœur s'emballe dans un effort physique et sportif intense,
l'accélération des battements cardiaques, l'emballement de la respiration,
l'afflux du sang dans le corps... Ici et maintenant, je sens ma poitrine qui
bouge au rythme des battements de mon cœur ! Je crois un instant que je
vacille, que je ne tiens plus la posture et pourtant non, je demeure
immobile ! Je mesure alors toute la puissance de la machinerie cardiaque
qui propulse des litres de sang dans les différentes parties du corps. Je sens
les pulsations du sang dans mes bras et jusqu'à l'extrémité de mes doigts,
reliés dans un mudra...
- A ce
stade, le monde extérieur a sensoriellement disparu. Je ne « vois »
plus l'obscurité, je « n'entends » (évidemment) plus le silence. Je
n'ai plus de ressenti de l'espace de mon corps. Ce ne sont plus ces pulsations
que je « perçois », je «suis » ces pulsations ! L'épicentre
de ce séisme sensoriel est au cœur de ma poitrine. Il vibre et résonne, s'expand
et rayonne au rythme de mes battements cardiaques. Au paroxysme de cet instant,
ma « présence consciente » se confond toute entière avec la « présence
physique » à mon corps. L'incroyable vibrato de ces pulsations l'éclaire
et détoure son tracé comme de la limaille de fer sous le champ magnétique d'un
aimant...
- Lorsque
l'alarme de mon téléphone portable sonne, ma « haute
sensibilité » s'évanouit avec ce
stimulus sensoriel extérieur. J'émerge lentement. Je mesure à peine la distance
parcourue depuis ce si lointain intérieur. Le sentiment d'être moi me recouvre,
tel l'océan la côte après marée basse. Jamais ne n'ai été aussi intensément
connecté à mon corps, aussi profondément ancré dans le moment prēsent, aussi éloigné
des fluctuations de l'imaginaire. Avec stupéfaction, je découvre qu'il est
(assez aisément) possible de repousser ma sensibilité bien plus loin que je ne le
croyais possible au point de sentir et de percevoir l'indicible ! Je sais
que ces stimuli sensoriels sont toujours là, à l'arrière-plan de ma perception
consciente et je sens également qu'ils ne sont «invisibles » qu'en
surface. J'éprouve le sentiment (évanescent sous le vêtement du
« sentiment du moi » qui le recouvre) d'en être en permanence « conscient ».
Le silence, la paix et la sérénité sont là, patients et immuables, derrière le
seuil et il me m'appartient (que) de me laisser imprégner...
En yoga, la méditation est décrite comme un processus en plusieurs étapes : retrait des sens, concentration, contemplation et samâdhi (qui comprend lui-même plusieurs phases). Chaque terme a fait l'objet d'explications plus ou moins « parlantes » selon le langage employé, la réceptivité et l'intuition des sages. Les récits d'expériences ne sont parfois pas toujours les plus clairs et leurs commentaires les moins abscons - je ne m'exclus pas du lot -. Lorsque nous débutons, nous aimons être guidé, accompagné, savoir ce qu'il faut « chercher », « éviter », « développer »... Sans mode d'emploi, comment savoir si ce que l'on fait est « bien », que notre pratique est la bonne ?
Plutôt que la méthode - variable à l'infini suivant l'enseignant et relative dans sa mise en application par chacun -, ce qui importe (et ce qu'enseigne notre pratique),quelle que soit la façon d'y arriver, le chemin emprunté et la durée du parcours, c'est un état d'esprit de neutralité. C'est s'établir et « demeurer » dans un état « d'observation attentive et vigilante ».
Observer avec neutralité, c'est regarder, écouter, sentir, percevoir avec tous nos sens, sans rien projeter, sans rien interpréter, sans rien juger. Cette attitude exclut toute volonté d'efficience, tout objectif et échéance. La neutralité, c'est saisir ce qui est, tel qu'il est « par-delà » le filtre de la subjectivité, « par-delà » le sentiment du moi. Cette impartialité implique « indifférence », « insensibilité », « mise en retrait », face à tout ce qui surgit, à tout ce qui nous anime et nous pousse à agir, pensées, désir, aversion, fausse connaissance... Il n'y a rien à vouloir, rien à rechercher, rien à éviter. Il y a à observer, sans attente, sans présupposer, sans présumer.
Observer avec attention fait ressortir les détails, purifie le grossier et sublime le subtil. Ce qui auparavant était masqué par le bruissement de la pensée, le bourdonnement du mental, le fredonnement de l'imaginaire se met subitement à résonner dans le vide et le silence de l'esprit.
- Mes battements cardiaques
se révèlent, plus qu'un son de tambour cadencé, un martèlement dont le battement
prend forme loin en amont où l'afflux du sang se rassemble dans les recoins de
mes organes et s'étire en aval de son reflux dans les couches profondes de mon
corps... L'obscurité n'est plus d'une
couleur noir ébène homogène et son fond n'est plus plane. Des éclats de
lumière diffuse, tels des éclairs électriques dans l'horizon d'un ciel d'orage,
zèbrent l'espace et le font se mouvoir pareil à la surface d'un océan d'encre...
- Les effets de cette observation attentive se
font sentir bien après être sorti de méditation. En parcourant à pied le chemin habituel pour me rendre à mon travail,
j'entends les chants des oiseaux avec une acuité redoublée. Leurs cris se
détachent avec précision dans une modulation de tonalités formant un concert de
différentes espèces. Les couleurs sont plus nettes, les lignes plus précises.
Je ne vois plus seulement des arbres, mais des entités distinctes, chacune
caractérisée par une forme unique, différente, riche de détails dans leurs
troncs, dans les faisceaux de leurs branches...
L'attention portée à ce qui surgit dans l'espace de la méditation n'entraîne pas la «sublimation » du sensoriel comme une déformation hallucinée de la réalité. Ici, pas d'effets psychédéliques, pas embrasement démesuré ou d'illumination extravagante, seulement ceci qui est, tel qu'il est.
Observer avec vigilance, ce n'est pas rester concentré sur un stimulus, fixé sur un objet avec la fermeté d'une moule ancrée à son rocher, c'est rester attentif à ce qui se dévoile lorsque la pensée cesse de recouvrir le mental, que notre champ de conscience s'élargit à la perception d'une richesse de détails auparavant invisibles et de dimensions jusqu'à lors insoupçonnées.
L'observation attentive et vigilante induit corrélativement un état de calme et de sérénité profond. Il se produit comme une sorte de « dépeuplement » de l'espace mental de la présence obsédante et fastidieuse du « moi », comme un reflux de l'océan à marée basse. Le champ de conscience, dégagé, épuré du subjectif, du personnel, du vouloir, désormais libre d'accueillir ce qui est, tel qu'il est, s'expand et s'épanouit dans l'éclosion du printemps de l'être.
Ma modeste expérience me suggère que cet état ne s'obtient pas à force d'habileté. J'ai l'intuition que la pratique assidue n'est pas un terreau duquel germe l'acuité sous l'éclat de l'attention et la rosée de l'effort, mais « l'opportunité » qui lui permet de s'exprimer. Je ne prétends pas que le samâdhi s'obtienne par la seule application de l'attention vigilante à l'observation du silence.
J'ai l'intuition de quelque chose de dissimulé sous le sentiment du moi, recouvert par l'habitude qui me fait me reconnaître « moi », au moindre feedback que me donne ma propre conscience d'exister, inversement proportionnelle à la neutralité de l'observateur.
J'ai l'intuition que l'observation attentive et vigilante est la clé pour épurer mon mental, révéler ce qui est, tel qu'il est dans le champ libéré de ma conscience et, «par-delà » « je », être ce que je suis, tel que je suis.

I.50.10 - Sérénité profonde
- Milieu de
cinquième semaine. J'avoue ne pas avoir beaucoup à dire au sortir de la
méditation du jour, si ce n'est que j'éprouve un sentiment de profonde
sérénité. Je m'applique à observer sans intervenir, à « habiter » la
posture de l'observateur neutre. Je laisse faire et je constate seulement ce
qui se passe.
- J'observe
mes battements cardiaques, la sensation de l'afflux sanguin, qui vont et
viennent en alternance. Lorsque le son disparaît, je me concentre sur la pulsation
qui ramène la résonance. J'occulte l'extérieur, silencieux, mais je scrute encore
l'obscurité par intermittence. Au début, elle est zébrée d'éclairs lumineux
diffus et étalés, aux formes indicibles qui vont en se raréfiant. L'obscurité devient
noire et uniforme. Lorsque je m'en aperçois, je constate également que ce
stimuli chasse les autres et prend leur place.
- J'observe une raréfaction très nette du contenu mental : plus de glissements oniriques, ni d'images vives et spontanées, pas de pensée, seule ma voix intérieure cherche, ici et là, à commenter. Lorsqu'elle s'élève, je me recentre sur l'observation. Demain sera différent, chaque jour l'est. Je sens toutefois l'apaisement s'installer. J'ai l'impression d'entrer toujours plus avant dans l'instant prēsent, désormais devenu un lieu naturel. Rester immobile, sans rien faire, est de plus en plus agréable. Chaque vecteur sensoriel devient en uniforme. Réunis, leurs frontières se font diaphanes.
- La sérénité
remplace le sensationnel. En ces instants, peu m'importe que la matière à commentaire
se raréfie et pour moi, chez qui l'expérience philosophique est au cœur de
l'existence, cela est particulièrement signifiant des effets de la méditation...

I.50.11 - Fermeté et aisance
(Fin avril - fin de septième et début de huitième semaine de méditation).
Je profite des quatre jours du week-end de Pâques pour méditer pendant deux heures chaque matin - ce qui n'est rien en comparaison des dix heures journalières d'une retraite vipassana... -. Je renforce également la fermeté de ma posture en contractant (modérément) certaines zones, à commencer par Uddiyana bandha. Contracter le ventre permet de soutenir mon dos et de me tenir plus droit. Cela permet également de soulever le sommet de mon crâne vers le haut tout en abaissant légèrement mon menton, créant une très légère contraction de Jalandhara bandha au niveau de la gorge. Je complète par Mula Bandha au niveau du chakra racine.
Ma posture est nettement plus tonique. Les premières semaines, je m'étais laisser aller à trop d'aisance avec pour effet de me tasser insidieusement, créant un inconfort dans mon dos. Mes genoux également avaient soufferts, en particulier le gauche. J'ai donc changé de position, passant de Sukhasana à Virasana avec un banc de méditation. Mes genoux replacés dans leur axe naturel, je n'ai désormais plus aucune douleur, ni inconfort. Ces rectifications faites, ma posture est désormais plus adaptée à mon anatomie.
Outre les bandhas, j'ai également testé de méditer à la lumière du jour naissant, plutôt que dans l'obscurité totale, les yeux mi-clos en regardant, sans le fixer, un point devant moi dans l'alignement de mon regard. Je n'ai pas constaté d'effet anti-somnolence, bien au contraire, j'ai eu plus envie de somnoler que les yeux fermés. A contrario, fermer les yeux et ajouter le drishti (le point de concentration du regard) s'est avéré plus efficace pour moi. Il suffit simplement de fixer un point imaginaire (comme le troisième œil au-dessus des sourcils ou droit devant soi) et de croiser le regard, comme de loucher, mais très légèrement afin que la pression sur les globes oculaires ne soit pas gênante. Une adaptation qui me convient personnellement, d'autant que j'ai constaté un désagrément au fait d'avoir les yeux mi-clos (peut-être aurais-je dû éclairer plus la pièce), ma vision est floue au sortir de cette dernière et longue séance...
Nonobstant, je constate une différence essentielle entre avoir les yeux fermés plutôt que mi-clos, c'est la sensation « d'intériorité », de glissement vers l'intérieur de soi. Je pense que le « retrait des sens », Pratyâhâra, est une étape importante pour l'entrée en état de méditation, même s'il implique d'être plus vigilant face au risque de somnolence. Toutefois, l'augmentation du nombre de points de concentration qu'entraîne le raffermissement de la tonicité de ma posture n'a pas empêché le surgissement de pensées et d'images mentales. J'ai même eu l'impression qu'il y en avait plus ! Il est cependant difficile d'évaluer correctement les choses, car chaque jour est différent et chaque méditation également...
La recherche de l'équilibre n'est pas facile. Lorsque je vais vers plus d'aisance (sukham) en relâchant ma posture, j'en viens à oublier mon corps, à me diluer dans l'espace et à me fondre dans le silence. Une sensation très profonde, empreinte de sérénité, voire d'une certaine félicité, mais dont la contrepartie est que mon esprit ne reste pas déserté longtemps et que le vide du mental semble attirer les images oniriques, une attraction renforcée par l'état de somnolence induit par la tendance à l'avachissement.
De l'autre côté, lorsque je vais vers plus de fermeté (sthira) dans ma posture, je suis pleinement ancré au monde. C'est à tel point que je n'ai nul besoin de « faire d'effort » de revenir à ma concentration. Lorsque je m'aperçois que je glisse vers un état liminaire de conscience, c'est aussitôt pour prendre conscience d'être ceinturé par ma posture, comme si mon esprit était ramené à la surface par la tonicité musculaire... La contrepartie, c'est que je suis totalement « dans la posture ». Il n'y a rien d'autre... (mais faut-il qu'il y ait autre chose ?) Comme si la tonicité bloquait toute pensée et toute image (jusqu'à un certain stade d'usure) et ne laissait rien entrevoir de l'intérieur de moi. J'ai l'impression de ne jamais « être en méditation », de rester bloqué sur le pas de la porte...La méditation ne se limite pas à une question de posture, mais, comme en yoga, c'est la base de l'ancrage.
Pendant les instants où mon corps s'efface, la saveur du moment présent est dépourvue de toute notion de durée. L'impression s'accompagne d'une plus grande proximité avec mon subconscient. Les images qui surgissent ont un caractère plus libre et spontané, plus intense et plus englobant.
Méditer pendant deux heures d'affiliées présente également un intérêt, c'est de faire ressortir des sensations antagonistes. Pendant la première heure, je parviens assez facilement à rester concentré sur tous les (nombreux) détails de ma posture. Le bruit de mes battements cardiaques est fort clair, de sorte que je peux y caler ma respiration (sur un rythme naturel d'inspire et d'expire de 2/4 - je pousserai à 3/8 avec la pratique -). Je suis alors pleinement concentré sur le moment présent, mû par ce rythme sans avoir de notion de durée, immergé dans l'instant sans percevoir l'écoulement du temps...
La seconde heure, j'ai plus de mal à maintenir ma concentration qui se délite progressivement. A force de marcher dans les mêmes pas, je finis par effacer mes empreintes et à perdre la conscience de ma marche... Le bruit de mes battements cardiaques se fait sourd, je mélange le décompte de mes inspires et de mes expires, ma tonicité musculaire se relâche. Et surtout, l'aspect le plus pénible est le sentiment d'une durée qui n'en finit pas. Le temps s'écoule avec une lenteur qui devient un véritable tourment ! Je le mesure d'autant mieux que j'utilise une application « timer » sur mon téléphone portable pour rythmer les demi-heures au son d'un bol tibétain. Pendant les moments où le temps devient pesant, mon état de veille est plus élevé et il devient de plus en plus difficile de rester immobile. Le mental me joue alors des tours. Des craintes surgissent quant aux risques induits d'une immobilité prolongée sur la circulation du sang dans mes jambes ou l'hallucination d'un réveil de la douleur dans mon genoux... Surtout, le besoin de bouger pèse sur ma concentration. Le temps devient une véritable épreuve...
Je ne considère pas qu'il soit pertinent de poser la question de l'utilité de méditer sur une durée, personnelle à chacun, au-delà de laquelle apparaît un inconfort mental. Il est normal de ne pas pouvoir maintenir la même tonicité sur la durée, ce qui ne veut pas dire qu'il faut « endurer » les désagréments de cet effort. J'en prends pour exemple ma pratique des asanas, dès lors qu'il n'y a aucune douleur physique, inutile et contreproductive, la pratique évolue dans un sens favorable. « Pratiquez, pratiquez et tout arrivera ! ».
Au sortir de ces méditations, il s'est d'ailleurs produit un « effet rebond » étonnant. Libéré de l'étau du temps, ma vigilance s'est soudain amplifiée et, même si je suis réveillé au sortir du lit, méditer s'est avéré incroyablement réparateur en comparaison du sommeil ! Peut-être est-ce dû au fait d'avoir établis un meilleur équilibre entre fermeté et aisance, « sthira et sukham »...
De plus, je constate un bienfait psychologique profond. Des situations qui me faisaient réagir vivement ne déclenchent plus d'émotion négative. Je n'ai plus besoin de me répéter « équanimité, équanimité, équanimité » pour demeurer équanime ! En mettant le jugement de côté, j'adopte spontanément la qualité d'observateur plutôt que le caractère d'acteur et j'y demeure centré, comme si la tonicité que j'ai « imposé » à mon corps pendant la méditation avait placé mon mental dans cette posture et l'y maintenait avec fermeté et aisance. J'observe en moi un détachement progressif et profond d'avec les problèmes du quotidien, parallèlement à l'installation d'une manière différente de voir les choses, comme un changement de perspective sur la nature et les êtres, instillée par la philosophie du Bouddhisme...
A suivre...
Références :
[i] Patanjali et le yoga, Mircea Eliade
[i] «
Les forces élémentaires au nombre de quatre : solidité, fluidité, chaleur, mouvement, considérées aussi comme inertie, cohésion, radiation, vibration et symbolisées respectivement par la terre, l'eau, le feu, l'air ou le vent »
BB-89
[ii] https://fr.wikipedia.org/wiki/Temps_de_Planck
[iii] Votre cerveau n'a pas fini de vous étonner, Collectif, page 108
[iv] Au cœur du cerveau - Qui décide ? https://www.youtube.com/watch?v=AO13T4hIIr4
AH-PP :
Aldous Huxley « Les portes de la perception », 10/18 Editions du
Rocher, 1954
BB : Le Bouddhisme du Bouddha, Alexandra David Neel https://archive.org/details/AlexandraDavidNeelBouddhismeDuBouddha?q=Le+Bouddhisme+du+Bouddha%2C+Alexandra+David+Neel
CT : La Connaissance Transcendante, Alexandra David Neel https://archive.org/details/AlexandraDavidNeelLaConnaissanceTranscendante/page/n7?q=Prajna%2Bparamita
DC : Théorie des douze causes, Professeur de la Vallée Poussin https://archive.org/details/pts_bouddhismetude_3720-0699/page/n5
ESBT : Alexandra David Neel - Les enseignements secrets des bouddhistes tibétains https://archive.org/details/AlexandraDavidNeelLesEnseignementsSecrets/page/n1