
II.8 - Poétique de l'ainsité
Retrouvez ici les poésies de l'ainsité de II.86 à II.97

La beauté du tragique
II.86 1883
Dès le début, ta fin fut le premier acte,
Qui imprima la marque de ton impact.
Au cœur de l’être résonne la présence,
L’expansion sonne l’heure de ton absence.
Ton dernier acte est le début du prochain,
De ton expire, s’inspire le lendemain.
Apparaître tel un éclair dans l’espace,
Se manifester avec forte audace,
En un souffle, t’autolibérer sans trace,
Ton absence est une présence vivace.
Bien que ton existence fût virtuelle,
Ta disparition n’en est pas moins irréelle !
Lobsang TAMCHEU
Éléments de réflexion
Comme la vague qui se retire sur la plage et laisse sur notre corps la trace de son passage, la sensation du sel sur nos pieds, la sensation de la force de l'océan sur nos jambes… lorsque le ressenti (la sensation, la perception, l'émotion, la pensée…), c.à.d. la manifestation spatio-temporelle de l'être (la Shakti), se retire et s'autolibère dans l'espace incomposé de la conscience (Shiva), disparaissant aussi spontanément qu'il est apparu, c'est comme si son absence laissait place à une… présence ! C'est comme si la manifestation après s'être autolibérée dans l'espace… était encore là !
« Ce qui sort du silence, se déploie à partir du silence et se résorbe dans le silence, n'est pas différent du silence » YTEB.
La « présence » et « l'absence » d'une chose sont deux objets de représentation mentale, deux objets de la conscience intentionnelle, respectivement modale et amodale. Sans objet ni sujet, « la conscience de l'absence de l'absence » (existant et n'existant pas à la fois) ne peut être véritablement conceptualisée par la pensée, ni saisie par la perception, bien qu'elle soit en-deçà du sujet et de l'objet. C'est une intuition, un pressentiment d'ordre métaphysique, reflet de la conscience spontanée, de la nudité spatiale…
« Quand la perception se dissout, l'imaginaire de la perception se dissout également, car elles ne sont qu'une seule chose. Lorsque l'on comprend cela intimement, il arrive le pressentiment que le silence dans lequel se résout la perception, le silence dans lequel apparaît la perception, et le silence sur lequel se surimpose la perception, ne peut pas être différent de la perception » YTEB.
Le phénomène ne commence pas avec « l'apparence » (chosification de la perception) et ne se termine pas par « l'autolibération » de son ressenti au sein de l'espace de sa « manifestation » – respectivement les trois moments de la respiration yogique, inspire, rétention poumons pleins, expire –. Lorsque l'émotion ou la pensée s'autolibère dans l'espace, elle laisse comme une trace de son passage, étrange et paradoxale, comme une rémanence, comme une sorte de « persistance sur la rétine du mental », trace spectrale, présence résiduelle de l'absence elle-même !
« Comme dans le ciel les nuages disparaissent dans l'azur, où qu'ils aillent, ils ne vont nulle part, où qu'ils soient, ils ne sont nulle part » LDE.
Lorsque ce qui ne peut se nommer « ni ceci ni cela » apparaît (comme s'il était) présent, c'est comme s'il était absent ! Et lorsque ce « ni ceci ni cela » disparaît, c'est comme s'il était non-absent en sa non-présence même ! Cela ne peut se concevoir avec des idées, se décrire avec des mots, se ressentir avec le corps… C'est d'un ordre si subtil qu'il en est indicible, comme le pressentiment d'une intuition… Et pourtant, la perception elle-même est déjà une fragmentation de l'incomposé – le silence, la transparence spatiale, le quatrième moment de la respiration yogique – (« effet de perspective » de l'anneau de Moebius de l'êtreté, Shakti comme la vue relative de Shiva) et… ne l'est pas ! En définitive, il n'y a ultimement, ni apparition, ni manifestation, ni autolibération de ce qui en son essence est sans essence (« libre d'assertion ») et en même temps, l'a-sensation de cette absence est plus présente que si elle était présence !
LDE : La libération par la disparition dans l'espace, cf. L'incendie du Cœur IDC-66
YTEB : Yoga Tantrique – Eric Baret https://www.youtube.com/watch?v=8tNyvAcVDo8
II.87 Destinée
Pour la flèche, la cible n’est pas un dessein,
Le point pour la ligne, le trait d’un écrivain.
Là où se porte le regard, va le cheval,
Sur l’horizon de l’agir nul axe cardinal.
A l’abandon dans l’action nul loi ni pourquoi,
L’au-delà des plaines sublime ce convoi.
L’arc décoche le renoncement spontané,
Sans intention, le trait fond, se laisse porter.
La chevauchée sans étreinte de l’émotion,
A brides relâchées, emmène l’expansion.
Des grands espaces, s’accomplit la traversée,
L’esprit unit au souffle de la liberté.
Lobsang TAMCHEU
Eléments de réflexion
Le Bouddhisme fait du lâcher-prise l’antidote du desir-attachement, alors que le Shivaïsme voit dans l’émotion l’expression même de la vie. Pour le premier, la libération est l’autre côté du samsāra et le renoncement le seuil de la porte. Pour le second, la vie n’est pas un poison ni le lâcher-prise son remède. La liberté est ici, dans l’attitude naturelle qui consiste à suivre le flux du mouvement naturel de la vie (apparition, manifestation, autolibération), à « se laisser agir », de laisser la vague de l’émotion (des perceptions, des pensées, etc.) se former, grandir, nous submerger, puis disparaître aussi subitement qu’elle est apparue !
« Regarde un objet, puis, lentement, retire ton regard. Ensuite, retire ta pensée et deviens le réceptacle de la plénitude ineffable. Le regard se fixe, la pensée s'arrête, le regard se meut, la pensée naît et s'éteint. Il ne reste que l'espace » VT
Si « le désir d’appropriation » (d’obtention, de réalisation !) est le problème – en ce qu’il déclenche un réflexe subjectif de contraction, de crispation égotiste, et de souffrance à sa rétention, par aversion ou par avidité – l’appropriation n’est pas antagoniste de la liberté (laquelle consisterait par opposition à laisser l’émotion circuler et s’expandre dans tout le corps jusqu’à dépasser ses limites et se diluer dans l’espace d’où elle provient), mais l’expression même de la forme-vide et du vide-forme c.à.d. une seule et même chose ! « Vie et libération sont notre propre esprit » dit Padmasambhava, les pendants de Shakti et Shiva, le manifesté dans les trois mouvements de sa « respiration cosmique » (inspiration, rétention, expiration), qui émanent du silence et y retournent ou qui, autrement dit, ne sont pas autres que les formes relatives de la vacuité lorsqu’elle apparaît comme « la cause et l’effet » selon l’assertion de Lama Tsongkhapa.
La véritable nature de la conscience est à la fois « libre d'assertion » en son essence et « libre d’appropriation » en son action, lesquelles libertés ne sont pas deux caractères différents, mais une seule chose. Selon l’acception courante, « être libre, c’est avoir le choix », la privation (arbitraire ou contingente) de cette possibilité étant synonyme de servitude. Or, choisir est une modalité de l’appropriation ! Dès qu’il y a objectif, il y a recherche d’obtention, y compris dans la voie spirituelle. Or, même l'Éveil n’est pas une « obtention » nous dit le Bouddha dans le sῡtra du cœur ! C’est pourquoi, l’on ne devrait pas pratiquer (les asanas du yoga, des rituels de purification, des récitations de mantras, etc.) aux fins de réalisation, mais pour célébrer la vie, pour célébrer la clarté !
«
La pratique rituelle, c'est une célébration de
la clarté. Ce
n'est pas le yoga qui mène à la conscience, c'est la conscience qui mène au
yoga », Abhinavagupta, Tantraloka YTEB
En son état de liberté naturelle, la conscience est spontanée, c’est une action sans agent, une marche sans marcheur, un flux de pensées sans penseur… Lorsque, tout aussi spontanément, se forme un point de vue intentionnel, telle une vague dans le mouvement de l’océan, la « figure d’interférence » qui apparaît alors est celle d’un agent, de son objet et de l’acte visant cet objet. La conscience se replie alors, tel un ruban de Moebius, en « conscience de quelque chose », et sous cette perspective vise à s’approprier quelque chose. Cet agent comme « principe égocentré » se condense alors en ego agissant, telle la formation d’une étoile à partir d’un mouvement d’accrétion dans une nébuleuse, à proportion du renforcement de ce désir d’appropriation. Dès lors, toute action intentionnelle de l’agent (y compris le souhait d’atteindre l'Éveil pour les biens de tous les êtres sensibles) devient samsārique et produit un fruit karmique !
« Sans l'idée de possession,
Une montagne vous appartient.
Sans cette liberté, une feuille vous lie ! »
IDC-56
Parallèlement, à l’instar de la matérialisation d’une particule sous les vibrations d’une corde quantique, un second niveau de pseudo fragmentation (laquelle n’est qu’un effet de perspective) se forme tel un épiphénomène, l’émulation d’un « je » sous l’effet de la conceptualisation du sujet-objet. Ainsi, la liberté de la conscience entraîne (sans la produire, puisque le phénomène demeure vide d’essence ultimement), l’apparition d’un sujet qui se saisit comme « soi », et dont l’illusion perdure par contraction, plutôt que de poursuivre son mouvement !
Si la liberté de la conscience ne rencontre pas de résistance, si elle n’est pas entravée par la crispation de la rétention égotiste, aussi spontanément qu’il survient, le mouvement s’inverse de lui-même, aussi naturellement que le flux et le reflux des vagues sur la plage, en se « laissant agir » par la perception, par l’émotion, par la pensée, jusqu’à s’autolibérer dans l’espace…
Lorsque se dissipe l’illusion d’un « soi » entitaire et souverain, que « les trois sphères » de l’agent, de son objet et de son action redeviennent vacuité, dans le flux du non-agir « libre d’assertion » et « libre d'appropriation », alors, puisqu'il n'y a conséquemment plus d'agent égocentré, d'action d'appropriation, et y compris de conceptualisation d'une dualité sujet/objet, toutes les formes de souffrance – du changement, de la douleur, omnisciente – s’évanouissent d’elles-mêmes ! C'est le nirvāṇa sans objet, sans support, sans affection. La conscience se fond et se confond avec elle-même, sans unité et sans pluralité, dans le mouvement naturel de la vie et la clarté de la transparence spatiale.
« Il n'y a pas d'état différent, ni aucun lieu où nous serions séparés de l'essence. Rien à faire qu'à continuer à être totalement présents (…) laissons-nous couler avec le flux du réel, sans attente et sans peur, sans attachement et sans détachement, dans la présence à l'instant » IDC-87
IDC : L'incendie du Cœur, Daniel Odier https://www.danielodier.com/french/bibliographie.php
VT : Vijñānabhaïrava, « tantra de la connaissance suprême », Daniel
Odier https://archive.org/details/daniel-odier-tantra-yoga-le-vijnanabhairava-tantra-le-tantra-de-la-connaissance-supreme/mode/2up?q=Daniel+Odier
II.88 Périple
Les colons creusent le samsāra des peines,
Là-haut, le vent courre joyeux sur les plaines.
Des regains verbeux, la morsure est cruelle,
La mélodie du silence, paix éternelle.
Le graal d’un avenir meilleur s’altère,
L’espace, jamais ne tombe en poussière.
Des vestiges, le passé fait table rase,
Le présent de l’instant, jamais ne s’érase.
Les ossements retournent à la terre,
Le temps poursuit sa course circulaire.
De la libération, la vie toujours vibra,
La réalité n’est pas autre chose que cela !
Lobsang TAMCHEU
Eléments de réflexion
Il y a toute une mythologie de l'Éveil, lequel est vu selon des traditions spirituelles comme un Himalaya à conquérir ou d'une simplicité enfantine ! Si l'on sort du cadran de la philosophie bouddhiste tibétaine et que l'on regarde du côté du Shivaïsme de Cachemire, l'Éveil semble beaucoup plus simple en ce qu'il est la reconnaissance de notre état naturel, de notre véritable nature, présence, en deçà de la conscience d'être conscient de soi, en deçà du « petit moi », du « je ». Toutefois, simple ne veut pas dire évident ! Et ce n'est pas un hasard si dans le Bouddhisme, l'Éveil est identifié à l'état de Bouddha. Car, ce n'est pas parce que l'on a reconnu sa véritable nature qu'il n'y a plus aucune empreinte d'appropriation, de desir-attachement ! L'on peut s'éveiller subitement sans pour autant être simultanément libéré de l'emprise du « je » !
Atteindre l'éveil « sans résidu » d'appropriation, implique un certain effort, lequel par ailleurs ne doit pas être celui du « petit je » ! Ce qui implique… un certain effort pour lâcher prise, raison pour laquelle dans le Bouddhisme, le renoncement (au samsāra) est la porte d'entrée dans la voie ! Il est également important de préciser que la purification n'est pas un objectif en soi. Lorsqu'il y a but, c'est le « moi » qui œuvre en tâche de fond ! Or, ce n'est pas le « je » qui se libère, car il est l'illusion ! C'est la présence/conscience qui s'abstrait de l'artifice de l'effet de perspective du « moi ».
Ainsi, les pratiques rituelles ne devraient pas être faites sous l'égide du « petit moi », ce qui est trop souvent le cas… Beaucoup de pratiquant s'enferrent dans leur pratique par abus de zèle – ce qui est une forme d'extrémisme qui écarte de la « voie du milieu » – dans le but d'atteindre l'Éveil des Bouddhas, sous couvert d'œuvrer par compassion au bien de tous les êtres sensibles (lesquels ne sont que des mots tant qu'il n'y a pas réalisation).
En toutes choses, toujours rechercher le juste milieu. Le rituel est une célébration, de l'émerveillement de la magie, du mystère, de l'être, de la conscience/présence en-deçà de toute conscience de soi. Toutefois, ce n'est ni le « petit moi » qui vise l'Éveil ni ne célèbre la reconnaissance de sa véritable nature !
Dans cet état d'esprit, des pratiques de Vajrāyana, tel que la récitation du mantra de Vajrasattva, ou de guérison du « Bouddha de médecine », seraient à pratiquer non pas aux fins de purifier son karman, de se guérir soi-même ou autrui, mais de célébrer la pureté de notre essence, quelles que soient les souffrances dont nous et les autres sommes affligées, lesquelles ne sont que les reflets de nos existences samsariques. Le rituel est l'occasion pour chacun, qu'il soit malade, blessé, en deuil, ou mort, quel que soit son état d'esprit, quels que soient les voiles qui le recouvrent, de célébrer la nature profonde, véritable, infrangible, de la conscience, au-delà de toute souffrance, de toute maladie, de toute peine, de toute affliction, plus vivante que la vie, plus vibrante que la plus puissante symphonie, plus inspirante que toute magie…
II.89 Paradis
Un endroit calme où coule une rivière,
Sous l’ombre d’un arbre près d’une clairière.
Un simple nom gravé au flanc de la pierre,
Marque la fin de ta course cavalière.
De tes agrégats dissous, l’humus s’imprime,
Nulle trace du soi, du sol à la cime.
Ta stèle est aussi vide que l’espace,
De la tristesse, la joie perce la glace.
L’océan de ton esprit, à perte de vue,
Embrasse l’horizon de son entrevue.
Ce passage n’était que le rêve d’un jour,
L’amour infini est l’Élysée du séjour.
Lobsang TAMCHEU
Eléments de réflexion
Il y a une dissonance dans le débat entre le Bouddhisme et le Shivaïsme sur la question du soi, le premier affirmant que tout est vide d'essence, le second que tout existe à la manière d'un soi universel et absolu.
« L'imaginaire est peuplé de rivières et de monts, rien d'illusoire, toute pensée crée une réalité absolue (...) Tout est vrai, palpable, vivant, frémissant » IDC-87.
Si l'on s'en tient à la définition selon laquelle la conscience est « toujours conscience de quelque chose », comment peut-on « prendre conscience d'une présence » qui, du fait de son caractère inconcevable et indicible, n'est pas de l'ordre d'un « quelque chose », c.à.d. qui ne peut se saisir comme représentation puisque, antérieure à tout état de conscience ?
Lorsqu'un puzzle est presque terminé, les pièces déjà assemblées forment une vue modale, comme celle d'objets existant en soi, les vides une vue amodale. Autrement dit, la conscience de l'absence surgit relativement à la conscience de la présence. A noter que les pièces présentent sont, ultimement, vides de substance et qu'elles ne sont donc pas, en essence, différentes des pièces manquantes ! Cette absence est double, c'est une absence vis-à-vis des pièces adjacentes et de leur propre vacuité d'existence. Nous sommes en présence « de l'absence d'une absence » qui se présente… comme la présence modale d'une absence amodale, autrement dit, un non-soi vu comme soi !
Et si, selon cette autre définition, il n'y a de conscience qu'en coémergence aux apparences, c.à.d. que « cela qui prend conscience de » existe simultanément à « cela qui est pris en conscience par », alors, cette présence ne saurait être antérieure à l'acte même fondateur de sa coexistence !
Autrement dit, c'est comme si la conscience avait deux niveaux : celui de l'objet abstrait de tout témoin ; et celui de la conscience de son objet, c.à.d. la « conscience d'être conscient de ». Lorsque « je » regarde le ciel, je peux oublier que je suis en train de regarder le ciel, mais je peux aussi, sous l'angle mort de l'abstraction du « je qui regarde », simplement « être le ciel », sans sujet ni objet, comme une perception sans aperception relative ! Toutefois, il y a toujours conscience sans quoi cette expérience ne serait pas possible, mais sans qu'il y ait « conscience d'avoir conscience de », sans un « je » ou un « moi ».
Pour le Shivaïsme, il y a un autre niveau, indicible et pourtant bien réel, d'une présence/conscience sous-jacente, à partir de laquelle émane la conscience d'être conscient de quelque chose, comme l'espace-temps le référentiel de toute manifestation phénoménale. Ce qui inverse l'affirmation de Descartes, « je pense donc je suis » par « c'est parce que je suis, que je peux penser » ! « Je suis » désigne ici cette présence/conscience spontanée (« conscience de l'absence d'absence »), qui rend possible, sans être conditionnelle, l'existence d'un flux de pensées sans penseur, à partir duquel va être émulé le « petit moi » dans la croyance d'être l'agent producteur de cette pensée.
Pour le Bouddhisme, il n'y a pas « je », de « moi », qui est conscient de, mais un simple courant ou un flux « d'actes de connaissance (perception, sensation, etc.) momentanées », il y a pensée sans penseur, propriétaire ou producteur de ces pensées. Le « moi », « je suis », est une illusion (non-soi, no vidyate), un simple « effet de perspective » sous lequel la conscience (spontanée en sa nature) se perçoit, s'instancie, comme intentionnelle, c'est la conscience de, qui pointe vers un objet (comme la flèche vers une cible) c.à.d. dont l'expérience (consciente) est la traduction/manifestation d'une croyance. Hors de l'objet de cette croyance (le « je »), point d'expérience de la conscience d'être en train de faire quelque chose ou… de ne rien faire !
En résumé, en deçà du « petit moi », il y aurait un flux de pensée sans agent, et en-dessous encore, la présence d'une absence, dont la reconnaissance serait affirmative de la déclaration, « je suis cela ». Cette reconnaissance de l'un dans la totalité, c'est comme de voir sa propre image dans un miroir qui se reflète sans fin.
« A ce moment-là, chaque conscience
individuelle est comme une flamme qui se reflète dans un miroir, et qui reflète
du coup la flamme de toutes les consciences rassemblées, alors elles
s'embrassent et accèdent à l'infini » RSCP.
RSCP : La reconnaissance du Soi par Colette Poggi https://www.youtube.com/watch?v=_rRa5r6EHLI
Maintenant, je vois
II.90 Pyrotechnie
L’écran noir de la nuit est déchiré d’éclairs,
Sous les artifices courent des chimères.
Les faisceaux dessinent un ballet céleste,
De l’objet, le témoin devient manifeste.
De la tension que le spectacle capture,
Sur le sujet se reporte l’enclosure.
Dans l’obscurité retombe le silence,
Le vide de l’instant devient évidence.
L’espace ne collecte pas les étoiles,
Le ciel n’attend pas que l’aube se dévoile.
Dans l’absence se révèle la présence,
S’éveille la nature de la conscience.
Lobsang TAMCHEU
Eléments de réflexion
S'il est effectivement vrai que « nous sommes ce que nous cherchons », alors pourquoi devons-nous le réaliser ?
« Nous le sommes, nous le savons,
mais nous ne savons pas que nous le savons ! » RSCP.
Nous ne nous rappelons pas les premières années de notre vie, car à cette période se produit un « élagage synaptique » qui, en façonnant de nouveaux chemins cérébraux aux fins d'efficacité cognitive, efface les souvenirs existants ! C'est comme si, en se retirant d'elle-même, la conscience s'individualisait de sorte à pouvoir mieux… se saisir en retour ! La quête commence alors jusqu'à son abandon, lequel coïncide avec sa propre reconnaissance.
« Le paradoxe de la quête est qu'il faut
Commencer à chercher
Mais qu'on ne trouve qu'en
Abandonnant la quête » IDC-87.
Lorsque corps et esprit (apparition, manifestation, autolibération et silence) ne sont plus vus comme opposés, mais saisis sans discontinuité ultimement et sans obstruction relativement, toute différenciation entre l'imaginaire et la réalité se dissipent également ! « Ni être ni non-être » se révèlent dès lors perçus… comme un soi !« Tout est vrai, tout est illusoire, tout est réel » IDC-40.
Comment ne pas douter du « soi » étant donné que la prise de conscience de la véritable nature de son esprit n'entraîne pas l'épure de l'empreinte du « je » ? Comment écarter la possibilité qu'il puisse s'agir de l'expérience d'une croyance, d'une projection de l'empreinte du « moi », comme un filtre déformant ?
Selon le bouddhisme tibétain, l'esprit est inconcevable, car sa nature est aussi dépourvue de substance que l'espace vide. De fait, il est tout aussi impropre de qualifier sa nature de « vide nihiliste » que de la définir comme un « soi » ! Seul l'esprit en sa véritable nature est à même de qualifier la véritable nature de l'esprit ! Comment ce qui est « libre d'assertion » peut-il se qualifier lui-même ? Il le peut… en vérité conventionnelle ! « Les apparences sont des productions interdépendantes infaillibles et que la vacuité est libre d'assertion » est une assertion valide sur le plan conventionnel portant sur une vérité ultimement vide !
Parfois, l'on savoure le fait d'arrêter de penser… et parfois l'on se rend compte qu'en allant jusqu'au bout de sa pensée… il n'y a plus lieu de s'immerger dans le silence pour le trouver ! Et si, en définitive, tout était une question de point de vue, s'il n'y avait ni pendant ni avant autres que relatifs à l'observateur ?
Que les vagues se déchaînent ou que la mer soit d'huile, l'océan est toujours l'océan ! Les aigus et les basses sont la musique, les crêtes et les creux sont l'onde. Ils ne sont pas deux ! Pourquoi donc devrait-on séparer ce qui est inséparable, inconcevable, non duel ? Je suis conscient de mes émotions, je suis l'émotion ou je suis sans être conscient d'être l'espace indicible, antérieur à toute antériorité, dans lequel surgit cette émotion… Je suis l'inspire, la rétention et l'expire… Je suis le silence duquel surgissent les apparences et auxquelles elles retournent… Je suis l'apparition, la manifestation et l'auto libération… Shakti et Shiva, simultanément manifestation et principe !
Toutes ces expressions ne sont que des modalités d'une seule et même chose, à la fois être et non-être, sur laquelle la pensée, en se fixant (sur la conscience qui se perçoit elle-même sous différents angles), discrimine sous des appellations distinctes : présence, conscience de soi, conscience de son objet... Il n'y a rien à éliminer, rien à purifier ni à transformer, puisque c'est déjà là ! Il y a simplement à « reconnaître » l'illusion de sorte à ne plus être l'objet de son artifice, et ainsi en toutes circonstances être conscient de sa nature.
Tout ce qu'il y a à faire est de « demeurer tel quel, sans contrainte ». Or, rester sans rien faire est la chose la plus difficile pour le « je » et pour cause ! « Sans contrainte » signifie abandonner tout objectif, toute détermination, et toute technique (pas d'objet visualisé mentalement ni de scan corporel, c.à.d. pas de « Calme mental » ou de « pleine conscience »), c.à.d. lâcher-prise sur toute forme d'appropriation. La méditation n'est pas une activité. Délibérément est un mot incompatible avec le Mahāmudrā. « Ne rien faire » implique aussi ne rien attendre, laquelle attitude est également une recherche d'appropriation !
Peut-on ne rien vouloir, c.à.d. ne rien désirer, ne rien attendre, et ne s'accrocher à rien ? A mesure que l'on cherche la nature de l'esprit, elle s'éloigne, parce qu'on ignore ce qu'elle est ! C'est comme de chercher quelqu'un dans une foule sans l'avoir jamais vu, ni même sans savoir si c'est une personne ! Alors, on imagine, on extrapole, on invente ! Et ce que l'on trouve, ce dont on fait l'expérience, ce n'est pas autre chose que nos croyances, nos projections réifiées !
« Je ne peux ni le concevoir, ni le poursuivre, ni l'atteindre.
Je ne peux ni m'en approcher, ni m'en éloigner
Car c'est la nature même de mon esprit »
IDC-85
Pourquoi trouve-t-on sans chercher ? Parce que la véritable nature de l'esprit est vide d'essence ! Le « moi » est comme une vague qui s'est formée à la surface du vide et qui s'est figée dans cet espace vide sur le seul support de l'appropriation, du désir-attachement, suspendu entre la recherche et l'attente, entre l'espoir et la crainte, entre le désir et l'aversion.
Lorsque l'on abandonne tout cela, et que cette « figure d'interférence », faite de tensions et de crispations se relâche et s'auto-libère naturellement dans l'espace, il ne reste rien… qu'un vide d'essence ! Ce qui apparaît alors, hors du couplage (de la coémergence) des apparences et de la conscience, c'est cette « absence d'une absence » qui se révèle comme une présence, stable, continue, omniprésente, qui est la nature même de l'esprit !
Saisir la véritable nature de la conscience, ce n'est pas l'acte de « prendre conscience de », car il s'agirait encore d'une activité d'appropriation, mais c'est « se laisser prendre en conscience par ». Ce n'est ni de l'ordre de l'être ni de l'ordre du non-être, ce n'est ni un soi ni non-soi, ce n'est ni ceci ni cela. La « reconnaissance du soi » selon le Shivaïsme du Cachemire, ce n'est pas l'acte délibéré de connaître, c'est la liberté absolue de « se laisser reconnaître », de se laisser agir par l'évidence. Ni « je pense, donc je suis », ni « je suis, donc je pense », et pour autant… ni « je me prends conscience » ! Pas de « je », pas de « donc », pas de « pensée », pas « d'être », pas de « rien » non plus !
« Ce que vous êtes, vous l'êtes déjà ! En sachant ce que vous n'êtes pas, vous vous en libérer, et ce qui reste, c'est votre état naturel ! » MEN
MEN : Méditer est notre état naturel, José Le Roy https://www.youtube.com/watch?v=_p5sMo6KRck
II.91 Découverte
Au profond de la pénombre, s’ouvre l’iris,
De l’œil, les parois du puits s’agrandissent.
Dans le tréfonds, apparaît un interstice,
L’aperception s’y insinue, inspectrice.
L’air frémit à l’extrémité digitale,
Les crêtes isolent l’espace amodal.
L’être surgit, spontané, d’entre les lignes,
De son sillage, le sens est le seul signe.
L’entre-deux est une surprise sidérale,
Totale transparence, nudité spatiale !
Présence vide à jamais identique,
Absence pleine toujours allégorique !
Lobsang TAMCHEU
Eléments de réflexion
La « voie du milieu » est et n'est pas un chemin ! Les extrêmes du nihilisme et de l'éternalisme délimitent ses contours, mais il n'a pas de forme propre. Il ne dit pas « c'est cela ou cela », mais se situe entre « ni ceci » et « ni cela » (ni être ; ni non-être ; ni être et non-être ; ni être ni non-être).
La nature de l'esprit est aussi dénuée de substance que l'espace ! Nous le cherchons comme si c'était quelque chose quelque part dans l'espace alors que… c'est l'espace lui-même ! Comme si c'était une présence alors que c'est l'absence, comme si c'était un état alors que c'est au-delà de tout état !
Entrer dans la voie du milieu, réaliser la nature de l'esprit, ce n'est pas ajouter, c'est soustraire ! C'est faire l'épure de tout ce qui occupe l'espace non pas « de l'esprit », mais l'espace qui est l'esprit ! Les perceptions, les sensations, les pensées, ne masquent pas la nature véritable de l'esprit comme les nuages le soleil, elles occupent cet espace sans centre ni bord, sans substance ni identité, qui est la véritable nature de la conscience !
Réaliser, ce n'est pas déconstruire. Il n'y a rien au « centre de l'être » qui ait été édifié par une cause, et ce centre lui-même n'est pas un « existant premier » ! Réaliser, c'est dénuder, libérer l'espace de la conscience, ce qui pour effet de révéler non pas son être modal, mais sa réalité amodale !
Cet espace, il s'agit d'en faire l'épure émotionnelle, c'est abandonner le désir d'appropriation, la recherche d'obtention, la quête de réalisation, mais aussi abandonner toute attente, toute réceptivité même, lesquelles ne sont que des formes d'appropriation passives ! Ensuite, une épure conceptuelle, qui consiste à abandonner toutes doctrines, à commencer par les extrêmes du nihilisme (qui se décline aussi comme une « vacuité littérale »), et de l'éternalisme (qui inclut l'idée de la vacuité comme « essence absolue ») ! Enfin, une épure sensorielle qui procède de l'évacuation, du déblaiement, de l'expurgation de tout ce qui est obstruer l'espace amodal qui est le cœur de l'être, ce qui inclut d'abandonner… la « pleine conscience », le Calme mental, mais aussi la « Vision supérieure » !
« L'assise est merveilleuse, indispensable et complètement inutile.
Comprenez la chose par vous-même » IDC-57
Ces méditations sont nécessaires (sur une voie progressive) pour canaliser l'attention, calmer le mental agité du « singe fou », développer la concentration, et réfléchir sur la vacuité du soi, mais elles ne permettent pas de saisir la véritable nature de l'esprit. Dans la technique du « Calme mental » telle qu'enseignée par le bouddhisme tibétain, il est question d'une étape de « l'excès d'application des antidotes », lequel inclut y compris… le « Calme mental » lui-même !
La conscience n'est pas un objet modal sur lequel il est possible de garder notre attention et notre vigilance fixées, sans ciller, pendant une durée indéterminée. Chercher le plein, c'est occulter le vide ! C'est en cela qu'il faut comprendre que la méditation n'est pas une activité. Le Mahāmudrā n'est pas une méditation ! C'est la nature de l'esprit désoccultée des voiles de l'illusion de l'être modal !
Ce qui fait effectivement de l'Éveil quelque chose de simple puisqu'il ne s'agit pas d'atteindre à une hypothétique transcendance, mais d'enlever ce qui fait obstacle à notre véritable nature ! Comment ? En ne faisant rien ! Car l'appropriation et la désobstruction (délibérée) sont des obstructions ! Ce qui inclut, la « libre circulation » des énergies (dans les canaux et les vents, etc.), dans les « voies du ressentir » (Vajrayana et Shivaïsme entre autres), comme « moyen habile » d'Éveil, laquelle est parfaitement « indispensable et… complètement inutile » !
« Tous les phénomènes sont comme des oiseaux qui traversent l'espace.
À cet instant, cela a du sens de rechercher l'essence de l'esprit.
Lorsque vous regardez l'esprit, il n'y a rien à voir.
Dans ce « rien à voir » vous verrez le sens profond.
La vue suprême est au-delà de toute dualité sujet-objet.
La méditation suprême est sans méditation.
L'activité
suprême est sans action »
LDE
Utpaladeva reconnaît ne pas savoir comment il s'est éveillé, parce qu'il n'était pas en quête de l'Éveil ! Toutefois, cette « absolue liberté » qu'il a reconnue en lui-même n'est pas le caractère propre d'un en-soi ! L'espace n'a pas d'intention !
Qu'est-ce que l'Éveil alors ? Simplement la désobstruction complète de tout ce qui occupe l'espace/conscience que Padmasambhava désigne comme « absolue nudité », « transparence spatiale de l'esprit ». La libération par la vue nue de la nature de l'esprit est la vue nue de la nature de l'esprit !
C'est aussi la distinction du miroir et de ce qui s'y reflète, l'analogie étant impropre puisque rien ne peut se réfléchir dans l'espace, mais la comparaison demeure pertinente s'agissant de l'absence de confusion qui caractérise également l'Éveil.
Qu'est-ce qu'un Bouddha alors ? Le centre soustrait du bord, où l'espace autour est sans discontinuité et sans obstruction à l'espace au centre …
« Notre corps est aussi impermanent qu'une plume
Voguant dans les airs d'un haut défilé montagneux.
Notre esprit est vide et lumineux comme la profondeur spatiale.
Détendez-vous dans cet état naturel, sans élaborations mentales.
Lorsque votre esprit n'a plus de support, c'est Mahāmudrā.
Devenir familier avec cet état dissout votre esprit en l'état,
C'est la spatialité »
LDE
II.92 Atmosphère
Dans l’éclat du soleil levant, tu disparais,
Et pourtant, en moi, ta présence transparaît !
Dans les limbes de l’obscurité, tu te fonds,
Pourtant, ton absence jamais ne s’y confond !
Devant mes yeux, tu es sans forme ni centre,
Pourtant, de mon être, tu es l’épicentre !
Un simple reflet sur l’eau en transparence,
Qui réside au sein de mon expérience !
Un fil de soie invisible sur l’espace,
Qui traverse le ciel sans laisser de trace !
Un éther de silence entre deux notes,
Qui vibre dans l’azur nimbée de son hôte !
Lobsang TAMCHEU
Eléments de réflexion
L'on pourrait croire que saisir une seule fois la nature véritable de la conscience, serait-ce l'entrevoir d'une manière fulgurante, suffise pour être submergé par sa « présence » et que la perdre de vue serait le signe que nous ne l'aurions pas véritablement trouvée, que ce ne serait pas cela. Mais, puisque la conscience est un « espace vide » au sein duquel apparaissent, se manifestent et s'autolibèrent les apparences conjointement à leur perception, ces alternances sont naturelles ! La question n'est pas de « perdre de vue » la scène où se déroule le spectacle envoûté par la magie de celui-ci, c'est plutôt de ne pas encore saisir que ce qui apparaît est aussi « vide » d'essence que l'espace de la conscience elle-même !
Dans le Shivaïsme du Cachemire, il y a aussi des pratiques de « visualisations » comme dans le Vajrayana. Schématiquement, elles visent à agrandir « l'espace intérieur » du corps sensible pour étendre la sensibilité vibratoire de la conscience de sorte à embrasser la totalité du monde et de ce qu'il contient jusqu'au limites du cosmos dans le frémissement de la conscience. Toutefois, il s'agit non pas tant d'agrandir cet «espace vide », qui est la véritable nature de la conscience en lui insufflant plus d'énergie, mais de le désencombrer, de le désobstruer des émotions, des sensations, des conceptions, en somme de tout ce qui masque ou empêche la véritable nature de l'esprit de se saisir elle-même, et toutes choses dans le même mouvement vibratoire d'une prise de conscience totale, dont l'omniprésence apparaît comme une omnipotence à l'éveillé.
Si nous sommes les vagues qui avons oublié que nous étions l'océan, pour autant, la réalisation de notre véritable nature ne change rien ! Que l'océan soit une « mer d'huile » ou une « mer déchaînée » par la tempête, la reconnaissance de ce que nous sommes ne se perdre jamais quelque soit les circonstances. Or, une métaphore plus exacte serait de dire que la conscience est l'espace occupé par l'océan lequel est l'allégorie des objets de la représentation, et que la véritable nature de l'esprit (rigpa) peut se saisir « dans l'intervalle entre deux pensées », c.à.d. allégoriquement au moment où l'océan se retire, soit à marée basse ou lors de la formation de la vague d'un tsunami…
A mesure que notre discernement s'affine, l'on peut observer au cours de la méditation que lorsque les objets de la représentation s'autolibèrent, il se produit comme un «d'appel d'air » lorsque l'on ouvre une porte ou une fenêtre, lequel peut brusquement accroître la taille et l'intensité d'un feu ! L'espace libéré par les pensées n'est pas soudainement réoccupé par l'espace vide de la conscience ! s Si tant est, il n'est pas possible « d'ouvrir l'océan » d'un seul coup par la volonté, fut elle toute puissante, tel Moïse, sauf à abandonner instantanément toute forme d'attachement – ce en quoi réside peut-être le sens de cette autre allégorie… – ! Et puisque qu'un abandon aussi radical et instantané n'est pas à la portée de tous, la voie est le plus souvent progressive. Il faudra donc procéder en élargissant les interstices pour « écarter le voile», sans toutefois y mettre d'effort, car la méditation du Mahāmudrā repose sur une « absence de contrainte » qui est l'abandon de toute forme d'appropriation !
« Tout se libère dans l'instant.
Rien à faire ou à éviter,
Le mouvement et l'immobilité sont conscience lumineuse.
Libre de la quête et de la pratique,
L'essence du Cœur inonde tout ton être »
IDC-92
Mais en premier lieu, comment distinguer la véritable nature de la conscience de la «conscience de soi » ? Par leur caractère ! L'une est un « phénomène composé », impermanent, l'autre un « phénomène incomposé » pareil à l'espace dépourvu de substance. Puisque l'esprit n'est jamais né, spatial par nature puisque « libre d'assertion », il demeure inchangé, et s'apparaît toujours constant à lui-même, comme s'il possédait une essence entitaire et nouménale, mais seulement comme si ! La vacuité n'est pas un en-soi ! A contrario, la « conscience de soi » est toujours relative à la position de l'observateur, c.à.d. contextualisée à l'état de ses cinq agrégats, et donc changeante – même si le « moi historique » nous donne l'impression d'être permanent dans le temps, nos souvenirs sont reconstruits à chaque fois que nous y accédons, ce qui fait de cette impression de continuité un effet de perspective psychologique) –.
De fait, même si cet espace naturel de l'esprit est (très) souvent occupé, il n'en est pas moins toujours « présent » ! L'image que nous renvoient nos yeux ne contient aucun point vide en son milieu, alors que le centre de l'iris est vide de cellules photosensibles. Le cerveau sait que ses données sont incomplètes, mais il nous donne à voir une image extrapolée. Vous ne voyez pas ce vide et pourtant il est là, même lorsqu'il est recouvert par un objet de la représentation mentale. Leur essence n'est pas différente ! Il n'y a pas ultimement de discontinuité entre l'esprit, vide par nature, ni d'obstruction relativement avec ce qui apparaît, se manifeste et s'autolibère spontanément dans «l'espace de la conscience ». En saisir la fluidité, c'est réaliser l'êtreté de la conscience !
II.93 Anastrophe
Comme le phare de l’œil éclairant l’ombre,
Danse sur la silhouette de la pénombre.
Comme la voix grondante du tonnerre,
Joue des éclats scintillants des éclairs.
Comme un nez saturé d’odeurs humides,
Surcharge le ciel d’ozone translucide.
Comme l’épiderme en alerte du félin,
Électrise la terre d’un pas aérien.
Comme la langue par sa dialectique,
Donne aux choses une saveur sémantique.
Comme le film de la conscience onirique,
Projette cette apparition fantastique.
Lobsang TAMCHEU
Eléments de réflexion
Lorsque les apparences et la conscience sont vues sans obstruction, l'esprit n'est plus alors envoûté par le spectacle de l'objet, et n'est donc plus confus quant à leur distinction. Quelle que soit la forme, la durée, l'intensité, d'une manifestation, l'esprit ne perd pas de vue qu'elle est vide d'essence. Il n'y a pas d'effort à faire, c'est spontané, et hors de notre contrôle. L'on ne peut pas l'accélérer ce qui serait y appliquer une force, seulement l'induire par l'abandon de tout attachement. Il n'y a pas de méthode, seulement demeurer dans le non-agir !
Abandonner toutes les modalités de l'appropriation, c'est aussi ne pas se laisser aller au doute. Ne pas croire que, si l'on perd de vue « la vue de la conscience » lorsque l'espace se remplit des objets de la représentation, c'est que l'on n'a pas « fait ce qu'il fallait ». Il n'y a rien à faire que de s'abandonner à l'abandon de l'attachement ! L'on ne peut augmenter le volume de cet « espace vide de la conscience » ni en évacuer ce qui s'y manifeste par la force. Il n'y a rien à faire que de laisser ce mouvement suivre son cours (de se « laisser agir ») et les apparences s'autolibéreront aussi soudainement qu'elles sont apparues.
« Dans ce grand abandon gît le secret auquel personne ne croit car il est d'une simplicité révoltante, il est la négation de toute voie, de toute emprise sur les êtres, de tout espoir, de toute trajectoire » IDC-109
Il ne s'agit pas de soi ! Ce n'est pas « moi » qui suis observé et qui me laisse agir sans réagir. C'est la vue de mon esprit qui se voit lui-même ! Transparente, spatiale, pure par essence puisque « vide d'essence », cette vue n'a rien à se reprocher, rien à craindre ni à espérer. Elle n'est pas l'ego !
Comprenez en l'éprouvant par vous-mêmes que cette vue n'a aucune réticence à se «laisser agir » par le ressentir, à se laisser pénétrer par les sensations les plus désagréables, à « faire corps » avec les émotions les plus vives, à se laisser traverser de part en part par les sentiments les plus douloureux, car ils ne sont qu'espace et retournent à l'espace d'où ils sont venus ! L'espace ne peut être animé comme un pantin de bois ! C'est « la saisie du soi » qui nous instille la peur de disparaître en nous faisant croire que nous existons de manière tangible. La réalité de la conscience comme celle de l'espace est sans dimension ni forme. Non-née, elle ne peut s'effacer et disparaître.
Le mental aimerait bien qu'il y ait quelque chose à faire pour « accélérer le mouvement », pour « être sûr du résultat » et s'en attribuer le mérite, expressions du désir d'appropriation qui est le propre de l'ego. Il n'y a rien à faire que de laisser les choses se mettre en place naturellement. L'espace ne perd jamais ses droits et n'a donc pas besoin de les reprendre ! La liberté est un concept inventé par (la préoccupation mondaine de) « la peur de perdre ». La liberté n'est pas quelque chose qui s'ajoute ou se retranche à l'esprit, elle est sa nature même, « libre d'assertion » ! L'instant présent n'est pas retranché du passé ni augmenté du futur, il demeure l'instant présent, « libre de durer » !
Douter d'avoir trouvé l'esprit, d'avoir saisi sa spatialité, et de ne pas pouvoir se maintenir dans sa « présence », envoûté, détourné par les objets de la représentation mentale, ne sont que des modalités déguisées de l'appropriation.
Il n'y a rien à faire que d'être patient, d'accepter que les choses ne se fassent pas instantanément ! Comme antidote au désir d'appropriation, il ne s'agit pas toutefois de « cultiver la patience » par la technique, l'effort et l'intention, mais simplement laisser le doute s'autolibérer dans l'espace, dans la vue de la vacuité de toutes choses y compris de la vue elle-même !
La vue est le médecin, le médicament et la guérison, de la confusion qui fait se confondre la vue avec le poison, la maladie et la souffrance ! C'est un peu comme si l'esprit, découvrant qu'il est le remède, guérissait aussitôt ! La vision nue de la nature de l'esprit est comme autoguérissante. Se « laisser agir » comme son propre remède est une question de foi. Développer la « confiance éclairée » dans la vue est un antidote à l'ego qui veut nous faire croire que sans effort, nous ne sommes pas sur la bonne voie. Non seulement, nous sommes sur la voie, mais lorsque nous posons, sans contrainte, notre vue sur la vue, et nous abandonnons à l'abandon de l'attachement, nous sommes la voie !
Il n'y a rien à faire pour que cela arrive ! Utpaladeva ne sais pas comment ça lui est arrivé, mais ça lui est arrivé parce qu'il s'est abandonné totalement ! Le résultat est la méthode. Le non-agir est un « attracteur étrange ». C'est le fruit qui fait pousser l'arbre qui va produire le fruit ! « La vision nue de la nature de l'esprit » est comme un effet sans cause, un résultat sans objet, une pensée sans intention. Plus l'on s'y abandonne et plus elle s'apparaît avec clarté, s'intensifie et englobe tout ce qui apparaît. Alors la vision de l'ainsité est globale.
« La voie est un jeu qui consiste à sentir que la seule chose passionnante dans la vie est ce vaste abandon à l'espace, tout en s'offrant le luxe d'attendre qu'espace et silence se manifestent tout doucement » IDC-89.
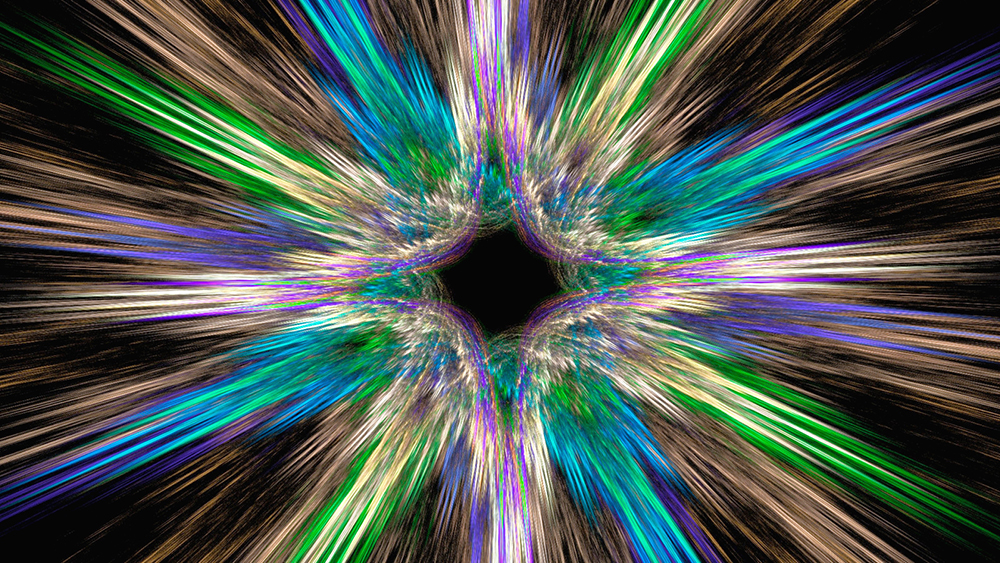
Fluctuations
II.94 Alizés
Les rayons de la Lune glissent sur le lac,
Sur l'étendue liquide courre le ressac.
La lumière file sur le régolite,
Le soleil balaie l'étendue sélénite.
La lueur funambule poursuit son ballet,
Sur l'étendue spatiale danse le reflet.
Sur le miroir du lac, l'écho de la Lune,
Des ondes du soleil reflètent les dunes.
Au centre de l'iris de l'expérience,
Convergent les alizés de la conscience.
Dans la vacuité de la coémergence,
L'espace se reflète en transparence.
Lobsang TAMCHEU
Eléments de réflexion
La « conscience de soi » est comme une ombre, dépendante de causes et de conditions, relative au moment, à la position de l'observateur et à son action. Tantôt courte tantôt longue, légère ou prononcée. Elle disparaît au zénith et lorsque le soleil se couche, pour reparaître sous les rets oniriques de la Lune.
La « saisie du soi » est comme le vent, imprévisible et changeant, léger ou tempétueux, rafraîchissant ou brûlant. L'ombre et le vent ne sont pas dépendant. La température peut baisser en plein soleil si le vent est froid, ou augmenter à l'ombre sous l'effet d'un vent chaud. Mais, leurs effets se combinent. L'air est plus chaud au soleil le jour et en plein été, plus froid à l'ombre la nuit et en hiver.
La « conscience » (en tant que nature) est comme l'espace, qui s'étend partout sans extension, toujours présent mais qui ne se conjugue à aucun temps, impalpable et intangible, sans centre ni bord, libre de toute cause, indépendant des conditions météorologiques sans lequel elles ne seraient pas possible.
La « saisie du soi » peut jaillir à n'importe quel moment alors que la conscience n'est pas tournée vers soi et que nous évoluons en « pilote automatique ». Lorsqu'elle surgit, c'est toujours brusquement et elle ravive immédiatement la « conscience de soi ». Et toujours, la conscience est là sans laquelle aucune expérience ne serait possible, y compris celle de… l'inconscience !
Le Bouddhisme décrit la nature véritable de la conscience comme une « claire lumière», une définition qui n'est pas à prendre au sens propre. Une lumière trop éclatante est aveuglante ! Mais plutôt comme un signifiant de lucidité, de « l'évidence du connaître». De fait, que je m'absorbe dans l'action au point de m'oublier, que je sois témoin de mon propre comportement ou vivement « saisit » par l'action, c'est toujours sur la base de cette « conscience en tant que nature ». C'est dans cette « transparence spatiale » de l'esprit que tous les phénomènes apparaissent, se manifestent et s'autolibèrent (ce qui est par ailleurs possible puisque ces phénomènes, « vides d'essences » sont tout aussi « transparents », c.à.d. sans discontinuité de nature, à la conscience).
En regardant vers cela qui regarde, ce que j'aperçois, ce n'est ni une présence (encore moins une personne), ni une absence (ou « l'absence d'une absence »). C'est le sentiment d'un état invariable. Où que j'aille, à quelque endroit que je me trouve, quelles que soient les circonstances, c'est là sans être véritablement là !
C'est comme un point invisible devant moi, au centre de l'espace, que je ne peux ni toucher ni bouger, et qui demeure toujours au même endroit quelle que soit la direction vers laquelle je regarde ! Je ne peux ni le diminuer ni l'agrandir. C'est simplement toujours là, inamovible, irréductible ! Je ne peux ni le soustraire, ni le retrancher, ni l'ajouter, et pourtant, ce n'est pas… toujours là !
Il arrive qu'il disparaisse, sans par ailleurs que je m'en rende compte, lorsque le spectacle de la vie, le mouvement de l'action ou la « saisie du soi » me submergent, pour… réapparaître aussitôt le calme revenu, sans effort, ni contrainte !
Si « la conscience comme nature » est ce qui rend possible l'expérience alors, en toute logique, la disparition de cette « non-présence inamovible et irréductible », puisque n'empêche pas la vue, ne permet conséquemment pas de voir ! Lorsque l'on pose l'esprit sur l'esprit, il n'y a rien à trouver hors de cela qui se pose ! La vue elle-même ! A la fois unique par sa nature, et multiple en l'infinie diversité de ses déclinaisons : la vue du spectacle, la vue du spectateur qui se voit assister au spectacle, le spectacle qui est vu sans que le spectateur se voit lui-même, la vue modale de l'espace où le spectacle a lieu, le vide amodal de l'espace incomposé… Tout cela compose « la vue » qui ne peut toutefois se saisir directement en tant que telle, car coémergente à la manifestation sans être la manifestation, et donc sans constituer une vue de la vue !
La « vue » est si transparente qu'elle l'est à elle-même, c'est pourquoi elle n'est pas vue alors qu'elle est cela même qui voit (sans être un vide nihiliste, car il n'y aurait alors rien… qui puisse voir) ! « Peux-tu dire : "Je ne vois [pas] la présence de l'Esprit" ? Alors que celui qui pense est cette réalité ! » IDC-66. C'est pourquoi, il est si difficile pour l'être ordinaire (non éveillé à la véritable nature de la conscience) de distinguer, par un discernement intuitif insuffisant développé, entre ce qui lui apparaît comme des moments de disparition de la vue comme l'état du sommeil sans rêve ou l'évanouissement – la « claire lumière » étant en réalité toujours là, y compris après la dissolution totale des cinq agrégats – et la simple… incapacité par manque de lucidité, autrement dit de sagesse qui « réalise la vacuité », à identifier la vue !
Dire que la vue est partout, est équivalent à dire que la conscience est toute chose. La conscience apparaît, se manifeste et disparaît en temps que le sujet et l'objet, et pourtant, la vue est toujours là ! La conscience peut se voir elle-même, et parfois s'oublier elle-même (lorsque le spectateur se confond avec le spectacle), alors que la vue demeure toujours invisible comme l'espace, et pourtant « la conscience en tant que nature » n'est pas autre que la vue ! La vue est à elle-même un « effet de perspective» qui s'aperçoit conscience !
La vue peut se superposer à n'importe quoi, prendre n'importe quelle forme, se projeter instantanément n'importe où dans l'univers, car elle est la vue de la réalité et la réalité elle-même ! Elle est infiniment malléable et en même temps insaisissable, claire et transparente comme l'espace. La vue ne disparaît jamais, même… lorsque nous la perdons de vue ! Nous pouvons temporairement avoir l'impression de « cesser d'être conscient », mais ne pas être conscient de la vue ne signifie pas qu'elle puisse cesser en son essence…
Aucun phénomène composé ne peut cesser
puisque que son essence est « vide d'essence », ni existant ni
non-existant ! Toute chose apparaît à la vue sous une forme relative à
l'expérience que la vue a d'elle-même comme conscience. La vue (Shiva) est à
la fois le faisceau qui éclaire, cela qui voit et cela qui est vu (Shakti). Toutes
les apparences sont la vue en même temps que la vue qui saisit les apparences.
Tout n'est qu'un « jeu de perspectives » sous une vue qui
s'apparaît conscience pour saisir la vacuité de sa vastitude.
II.95 Fluidité
Par rafales, le vent ratisse les dunes,
Hérisse la peau d’une brise opportune.
Sur l’océan de grains joue la cavalcade,
D’un monde de sable zébré de torsades.
Les rets de silice ondulent silencieux,
Les crêtes serpentent en sifflant sous les cieux.
Le désert fluide se meut par millimètre,
A sa surface courre l’anémomètre.
Sous une chaleur ardente de suffocation,
Les pensées volent sous le vent des émotions,
Dansant sur la pointe d’un spin atomique,
S’autolibèrent dans l’espace cinétique.
Lobsang TAMCHEU
Eléments de réflexion
L'esprit est aussi léger et volatil qu'une plume soulevée par le vent. Sous l'effet des émotions grossières ou des sentiments subtils, l'esprit virevolte aléatoirement dans toutes les directions. Or, la coémergence des apparences et de l'esprit ne s'entend pas seulement au sens de la relativité du sujet à l'objet (en tant que l'existence de l'un rend possible l'existence de l'autre, c.à.d. la conditionne de manière causale sans pour autant la précéder dans le temps), mais au sens où une seule chose (la conscience) est l'essence de toutes choses. Mais, comment le monde peut-il présenter cette apparente stabilité tout en étant par ailleurs la déclinaison des modalités de l'expérience d'une nature totalement éthérée ?
Combien y a-t-il de chakras ? Selon que l'on croit qu'il y a trois, cinq ou sept, l'on fait l'expérience d'en ressentir trois, cinq ou sept ! Puisque tout vibre de l'atome aux étoiles en passant par nos cellules, n'est-il pas réducteur de penser que c'est du bon fonctionnement des chakras que dépend la santé de l'agrégat du corps ?
Dès lors que tout vibre, aucun mouvement fut-il extrêmement subtil n'a plus d'importance qu'un autre fut-il grossier ! L'on ne peut dissocier la partie du tout, l'une n'existant pas sans l'autre, sans par ailleurs ni pluralité ni totalité. Le mot substantifie la chose. Un désert de sable n'est qu'une simple désignation apposée sur une étendue infinie de grains de sable, lequel est un état de fluidité en mouvance constante à l'intérieur, et qui se déplace aussi globalement.
Ultimement, il n'y a pas d'objet qui se meut, il n'y a que du mouvement qui apparaît comme objet, lequel n'est autre que l'espace qui adopte une forme de manifestation (« la vacuité qui apparaît comme la cause et l'effet »), puis s'autolibère dans l'espace, lequel est conscience et son essence vacuité.
Qu'est-ce que l'énergie ? Une variation de la perception-représentation ! Une modalité de l'expérience de la conscience !
Toutes les apparences proviennent de l'espace incomposé, se manifestent comme vibrations/énergie à l'échelle atomique et comme phénomène composé à l'échelle macroscopique, avant de se résorber dans le mouvement, lequel redevient espace et conscience dans son déploiement naturel. Se comprend ainsi le fait que l'esprit puisse être à la fois extrêmement volatil, et sujet à la moindre variation émotionnelle comme une plume qui serait emportée par le vent dans un haut défilé de montagne, et que toutes apparence présentent un caractère stable.
La
conscience du monde est son expérience.
II.96 Créativité
Du bonheur, cherchons à boire le calice,
Sa répétition est notre grand délice.
De la souffrance, fuyons le maléfice,
Sa répétition est notre grand supplice.
Eden et enfer ne sont que vues de l’esprit,
De la sagesse, l’ignorance assombrit.
Toute chose est un instant unique,
En permanence, rien n’est identique !
Le présent actuel est constante nouveauté,
La magie est le cœur de la pluralité.
Vide est l’apparence conventionnelle,
Tout est, et n’est pas, singulier et pluriel !
Lobsang TAMCHEU
Eléments de réflexion
En science, une théorie est validée si le résultat d'une expérience qui la démontre peut être répété à l'infini. Or, pour reproduire un même résultat, l'expérience doit s'abstraire de l'espace et du temps, ce qui lui confère par là-même sa validité, en n'importe quel lieu, à n'importe quelle époque et à n'importe quel moment. Or, il y a quelque chose de paradoxal à s'abstraire de l'espace et du temps pour établir les lois qui gouvernent les phénomènes… à l'intérieur même de l'espace-temps !
« Le samādhi est la conscience ininterrompue de notre propre essence (…)
il n’y a plus de séparation, plus de dualité (…)
lorsqu’on entre dans cet état, lorsqu’on est présent à la totalité de la sphère,
il n’y a plus ni temps ni espace » IDC-93
Bouddhisme et Shivaïsme se distinguent sur des points de théorie, mais aussi de méthode comme le fractionnement opposé à la globalisation. L'enseignement du Bouddhisme, en particulier tibétain, procède en effet de la subdivision par : la division des « étapes de la voie vers l'Éveil » (Lamrim) en étapes intermédiaires, elles-mêmes subdivisées en étapes de pratique ; la distinction de la sagesse et de la compassion ; par la voie elle-même qui va « de l'être vers le tout » – lequel s'entend comme la vacuité d'essence du « corps de vérité » des Bouddhas (Dharmakāya) sans différenciation ultime, alors que le « corps de manifestation » (Nirmānakāya) les distinguent individuellement –.
Le Shivaïsme du Cachemire a une approche globale qui consiste à ne pas établir de séparation sur quelque plan que ce soit (sensoriel, mental, etc.) entre le corps et l'esprit, l'individu et le monde, l'être et le cosmos.
« Ton corps cosmique se manifeste en totalité,
le cosmos frémit en ta propre demeure ! » IDC-93
Le Mahāyāna transpire du discours sur la compassion dont le Shivaïsme semble totalement absent. Et pourtant, le samādhi des tantrikās est l'abolition de tous les opposés (l'individualité versus l'altérité, moi et les autres), lesquels ne sont que de simples désignations ! L'ignorance induit la convoitise et le désir-attachement, que gomme la reconnaissance de notre unité indivise (car vide d'essence).
Pour autant, l'unité au-delà de la pluralité du samādhi des tantrikās ou de l'Éveil selon le bouddhisme, résonne du fait que « personne n'a jamais atteint l'éveil au cours de la méditation, mais toujours dans la confrontation avec le réel » IDC-93. Le terme «confrontation » s'entend au sens de « rapprochement ». Toute pratique axée sur le désir d'obtention éloigne de la réalisation (qu'il consiste dans le « retrait des sens » prôné par Patanjali, le « Calme mental » ou la « Vision supérieure » du bouddhisme). «Nous évitons ainsi le plus grand piège, celui de répéter l'expérience (…) L'important est de ne pas induire un état, même s'il est agréable. Si nous le faisons, la quête se resserre complètement » IDC-94.
C'est seulement en (se) saisissant (au sein de) la « totalité » (sans distinction entre l'extérieur et l'intérieur, entre le corps et le monde, entre l'esprit et le corps) que l'Éveil survient en tant qu'il constitue la « vue » de l'identité (ultime) de l'essence et des apparences, autrement dit la « saisie directe » de l'ainsité, ou des « deux vérités » (conventionnelle et ultime) ! « Nous perdons tout point d'appui, tout repère et, surtout, toute dimension connue. Nous entrons dans une dimension qui n'est plus ni l'espace ni le temps, mais l'infini » IDC-93.
« Nous connaissons vraiment l'émerveillement parce qu'il n'y a jamais répétition.
La répétition engendre stagnation, resserrement, mort.
Lorsque nous parlons de contraction de la Shakti,
il s'agit justement de ce
désir de répéter des choses qui sont uniques »
IDC-99
II.97 Infinité
Pas à pas, le plongeur entre dans l’océan,
Au contact de l’eau s’habille du vêtement.
Son corps se coule dans le mouvement des flots,
Dans l’onde aquatique, se fond crescendo.
Le son s’unit au silence des abysses,
De la quiétude, l’initiatrice.
Dans la contemplation de l’infinitif,
Au présent de l’être, nul contemplatif !
La forme de l’eau apparaît sans volonté,
La vague est de l’espace manifesté !
Pensées et penseur se libèrent aussitôt,
La conscience est le cosmos in extenso !
Lobsang TAMCHEU
Eléments de réflexion
Nous naissons, nous vivons et nous mourrons. C’est l’ordre naturel des choses et ne pas l’accepter est cause de souffrance. Alors, pour éviter de souffrir, nous croyons que nous « venons au monde » pour une bonne raison, que nous avons une « mission de vie» à accomplir, et que la mort répond à une raison précise, même si elle nous échappe. La mort nous effraie parce que nous ignorons la véritable nature de la réalité, notre véritable nature, et que la conception dualiste nous tient éloigner de notre propre « totalité indivise » aux fins d’entretenir le désir d’appropriation et l’attachement. Ce qu’il nous faut, c’est changer de paradigme !
Lorsqu’il est dit dans les textes que les pensées dans l’esprit sont comparables à des nuages qui disparaissent dans l’azur « Où qu’ils aillent, ils ne vont nulle part, où qu’ils soient, ils ne sont nulle part » IDC-66, ce n’est pas seulement de l’esprit dont il est question, mais également du corps et… de la vie elle-même ! Nos existences sont aussi intangibles que les nuages, sans plus consistantes que les pensées qui surgissent soudainement au cours d’une méditation et disparaissent tout aussi subitement ! L’infinie diversité de l’infinie combinaison des choses est unique ! L’instant présent est unique ! Pensées, esprit, corps, vie, monde ne sont que des vagues « d’actes uniques de connaissance momentanée » dans l’océan de la conscience, qui apparaissent et disparaissent dans l’espace intangible de l’expérience, sous des modalités conventionnelles, en un flot impermanent et incomposé, dans un mouvement sans mouvement…
« Le mouvement est l'aspect essentiel du yoga, la liberté d'un fleuve qui suit son cours vers l'océan et ne conceptualise pas les méandres, les crues, la sécheresse, l'élargissement ou l'atteinte du vaste espace dans lequel il se déverse enfin (…)
L'effort pour mieux cerner est l'abandon des limites (…)
Alors s'installe la grande fluctuation, nous nous
étendons et nous revenons vers notre centre sans jamais quitter la source
originelle. Chaque point du mouvement est alors l'immensité même et la vague du
Réel ne pense ni sa chute vertigineuse ni son ascension fulgurante qui
s'éparpille en écume argentée dans l'espace du ciel » IDC-98.
